Après un premier article sur les gauches au XVIIIe siècle, je peux désormais m’attarder sur le XIXe siècle, le point de départ que j’avais sélectionné pour l’histoire des droites. En effet, comme nous avons pu le voir avec Jacques Julliard, si les gauches se définissent par un projet politique reposant sur des piliers dont l’origine peut remonter (entre autres) aux Lumières, les droites ne naissent qu’en réaction à la Révolution, par un simple contre-projet de défense de l’ordre établi. Leurs divisions, sous la Restauration entre ultras royalistes et constitutionnels (les futurs légitimistes et orléanistes), concernent simplement le degré d’opposition à la Révolution passée : complète pour les légitimistes qui rejettent les droits de l’homme et la souveraineté nationale au profit de la souveraineté royale, et partielle pour les constitutionnels qui refusent la démocratie défendue par la révolution de 1793 tout en acceptant les principes de 1789 et la souveraineté nationale.
C’est la raison pour laquelle on ne peut parler de droites avant la Révolution : avant la naissance de la contre-révolution, de l’opposition royaliste libérale à la Terreur, puis de l’irruption de Napoléon Bonaparte, les droites n’existent pas, car les gauches n’existent pas non plus. « L’histoire des droites » avant la Révolution, nous pourrions dire que c’est simplement l’histoire politique de la monarchie et de l’Église catholique, hégémoniques ; les notions de souveraineté populaire et de droits de l’homme, de progrès et de justice, sont alors très largement marginales. Les « droites » sans adversaires ne prennent, on l’a vu, même pas la peine de se théoriser et de s’affirmer en tant que telles. Là où les gauches pensent puis se pensent, les droites « sont » .
Pour autant, il ne faut pas nier le caractère transitoire, mouvant, du champ politique, et ses recompositions permanentes : originellement, à la Révolution, droite et gauche s’opposent sur la question de la souveraineté populaire, et au fil du XIXe siècle, plus précisément sur l’idée de République. Or, à partir des années 1890, même la droite adhère à la République, au suffrage universel et à la souveraineté populaire : les « nouvelles droites » sont dès lors républicaines, alors qu’elles auraient été considérées de gauche quelques décennies plus tôt. Comme le dit Maurice Agulhon, « droite et gauche ne se définissent pas par des contenus de programmes mais par des constantes de positionnement dans des affrontements variables de programmes » ; autrement dit, les droites, même si elles peuvent adhérer à un moment donné aux positions des gauches, se reconstituent en se positionnant sur un nouveau combat, une nouvelle fois de façon conservatrice. L’orléanisme avait par exemple été de gauche sous la Restauration, avant de devenir une force conservatrice une fois parvenu au pouvoir. Droites et gauches, ainsi, se définissent mieux par « dynamisme abstrait » . La pensée de droite, pour Maurice Agulhon, c’est se dire : « on sait ce que l’on a, qui est vaguement acceptable, tandis que l’innovation offre des risques qui ne le sont peut-être pas » . Au contraire, la pensée de gauche, c’est se dire : « il y a des maux à corriger ; puisqu’il y a eu, dans le passé, des réformes heureuses, prenons le risque de nouvelles pour demain » . Le conservatisme prudent s’oppose à l’optimisme rationaliste.
Au cours de cet article, j’utiliserai deux ouvrages : celui de Jacques Julliard déjà évoqué1, et l’œuvre collective dirigée par Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, l’Histoire des gauches en France2, dont le premier volume se focalise sur le XIXe siècle. Le livre de Jacques Julliard servira de « colonne vertébrale » à cet article, en tant que synthèse complète et chronologique, tandis que le travail collectif dirigé par Jean-Jacques Becker et Gilles Candar complètera cette approche sur plusieurs thèmes. Ces deux auteurs notaient par ailleurs qu’au moment de l’écriture de leur livre, il n’existait pas de synthèse complète de l’histoire des gauches, contrairement aux droites : bien que des livres synthétisant l’histoire de certains courants (comme le socialisme, l’anarchisme ou le mouvement ouvrier) existaient, les gauches sont par nature plus disposées au changement que les droites, conservatrices, rendant plus complexe le fait de les appréhender dans leur globalité. Là où les chefs s’affrontent à droite, des idées s’affrontent à gauche, en particulier entre révolution et réforme ; une autre raison est que, selon Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, les historiens étaient persuadés de la victoire d’une gauche à l’avenir, et s’intéressaient donc aux courants eux-mêmes, dans l’idée que l’un d’eux l’emporterait. Cette prédiction n’est aujourd’hui plus partagée.
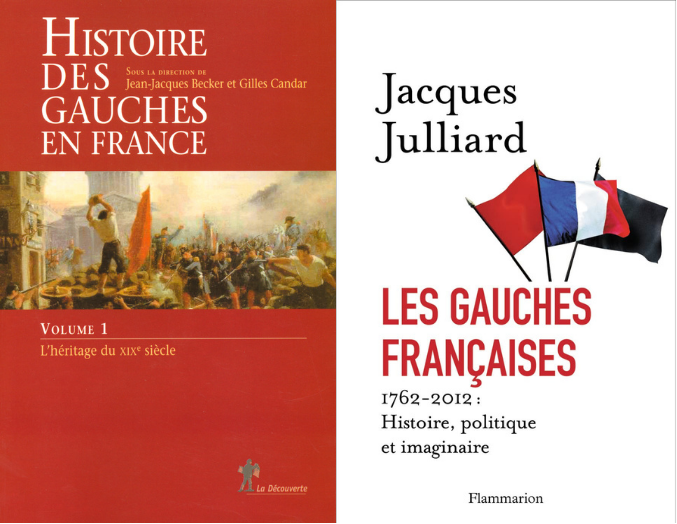
L’époque considérée ici sera celle du XIXe siècle, traité de la Restauration en 1814 à l’avènement du gouvernement de Défense républicaine formé par Waldeck-Rousseau en 1899. C’est à cette époque, pour Jean-Jacques Becker et Gilles Candar, que les gauches prennent leurs traits distinctifs en adoptant leurs traditions, et en se confrontant à ses deux principaux débats internes : la question sociale et la question nationale. C’est durant ce siècle que la gauche, assimilée à la République après la chute du Second Empire, fait admettre plusieurs principes de façon pérenne, après les premiers acquis de la Révolution (égalité civile par la fin des privilèges et l’application d’une même loi sur le territoire, biens nationaux, système représentatif élu limitant le pouvoir exécutif, liberté de la presse et des cultes, jury populaire…) : le suffrage universel masculin pour élire la Chambre (désormais le pouvoir prééminent), les libertés d’association, de réunion et de la presse, l’instruction gratuite, laïque et obligatoire, la fête nationale du 14 juillet, l’hymne national de La Marseillaise… Ces idées sont celles de la gauche, et elles s’imposent progressivement en tant que politiques publiques, puis à l’ensemble du champ politique, les droites finissant par adhérer à la République au cours des années 1890. C’est ensuite, en 1899 avec Waldeck-Rousseau que les gauches font l’expérience du pouvoir pour instaurer une République sociale opposée aux droites antidreyfusardes et nationalistes
Les gauches sous les monarchies censitaires : l’adhésion au libéralisme (1814-1848)
Après la Révolution et la période napoléonienne (durant laquelle les gauches sont réduites à l’impuissance politique et intellectuelle), le libéralisme politique renaît sous la monarchie censitaire, au cours des règnes successifs de Louis XVIII (1814-1824), Charles X (1824-1830) et Louis-Philippe (1830-1848). Dernier retour de l’archaïsme, cette période est aussi un tournant, avec plusieurs intéressantes transformations institutionnelles annonçant la modernité. Tandis que les droites acceptent peu à peu le nouvel ordre révolutionnaire, les gauches apprennent la pratique démocratique et parlementaire, afin de faire advenir concrètement la liberté après son avènement philosophique. L’héritage de cette époque, selon Jacques Julliard, se traduira dans les institutions de la IIIe République, à travers ses Assemblées inspirées de celles de la monarchie censitaire.
J’ajouterai ici un point pour clarifier le champ politique de cette époque. Sous la Restauration, on distingue au sein de la Chambre trois grandes mouvances : les ultras royalistes, à droite, favorables à la Contre-Révolution et au rejet de tous les acquis de la Révolution pour plutôt revenir à une société traditionaliste où l’aristocratie foncière serait prépondérante, tout comme l’Église, et le rejet de toute souveraineté populaire ; les constitutionnels et les doctrinaires, au centre, souhaitant défendre la Charte constitutionnel, texte garantissant certains acquis de 1789 comme l’égalité civile, comme la liberté de la presse et le groupe social de la bourgeoisie ; et les indépendants, à gauche, libéraux souhaitant un régime parlementaire ouvrant le suffrage à de nouvelles couches de la population. Cette segmentation du champ politique est ici relative au découpage spatial de la Chambre : les « indépendants » sont ici placés à l’extrême gauche, sans pour autant être républicains. Ce qu’on définit comme « gauche » et droite », dans cette Chambre, a donc plus à voir avec le positionnement relatif des groupes les uns par rapport aux autres qu’à une catégorisation absolue. Les indépendants ont cependant, comme l’explique Nicolas Bourguinat dans l’ouvrage collectif de Candar et Becker, un positionnement tranché en faveur de la souveraineté nationale plutôt que monarchique.
Pour Gilles Candar et Becker, à cette époque, c’est en réalité le rapport à l’Église catholique qui permet de déterminer l’appartenance à la gauche ou à la droite, mais d’autres critères peuvent être utilisés : la défense de l’individualisme (à gauche) ou du principe holiste (à droite), le combat pour l’égalité (à gauche) ou le maintien des inégalités (à droite)… Cependant, alors même que chaque parti adhère à une mémoire « de gauche » ou « de droite » , le champ politique se recompose en permanence selon de nouvelles cultures, représentations, et positionnements politiques, et une position adoptée par un parti de droite aujourd’hui aurait sans doute été perçue comme de gauche deux siècles plus tôt : des précautions sont donc nécessaires lorsqu’on veut attribuer une étiquette à une structure ou un individu. Toujours est-il qu’ici, on pourrait considérer que seuls les ultraroyalistes sont réellement de droite, s’opposant à tous les principes de la Révolution, alors que les constitutionnels y adhèrent et les défendent contre les ultras, et que les indépendants veulent même aller plus loin. Les positionnements évolueront sous la Monarchie de Juillet : les constitutionnels, devenus la majorité conservatrice opposée aux réformes, pourront alors être considérés comme étant de droite.
Dès la Restauration, le débat parlementaire est donc vif, entre partisans et opposants de la Révolution, car les principes révolutionnaires (système représentatif, liberté de la presse et des cultes, jury populaire) ne sont définitivement ancrés qu’en 1830. Sous la Restauration (1814-1830), chaque sujet peut donc mener à des débats intellectuels et philosophiques liés à ces grands principes : on trouve ainsi, parmi les célèbres orateurs, Bonald chez les ultras, le comte de Serre pour les ministériels, Guizot du côté des doctrinaires, Benjamin Constant chez les libéraux… Les quatre sujets principaux étant la question du régime électoral, celle de la responsabilité ministérielle, celle du statut de la presse, et celle des rapports entre l’État et l’Église.
Cette monarchie est dite censitaire : comme aux débuts de la Révolution (malgré l’opposition de Robespierre et de Condorcet), seuls les plus riches peuvent élire leurs représentants au sein de la Chambre des députés (en versant 300 francs d’impôts directs, et 1000 pour être éligible, la Chambre étant élue pour cinq ans et renouvelable par cinquième chaque année), alors que les membres de la Chambre des pairs sont nommés par le roi ou héritent de la pairie de leur père. Ces assemblées sont cependant indépendantes, et peuvent s’opposer à la volonté du roi.
La loi Lainé de 1817 fixe le régime électoral avec un scrutin départemental avec collège unique, favorable à la bourgeoisie censitaire, alors que les ultras souhaitaient instaurer un premier collège à hauteur de 50 francs d’impôts directs, afin que les masses rurales « dociles » choisissent des candidats ensuite sélectionnés par les électeurs à 300 francs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les droites ne sont donc pas nécessairement opposées à l’élargissement du suffrage, surtout au sein des droites populistes, alors que la gauche libérale soutient la bourgeoisie censitaire et se méfie des masses, la rapprochant de la droite libérale et du centre. Cependant, après l’assassinat du duc de Berry (fils du futur Charles X) le 13 février 1820, le régime influencé par les ultras se radicalise, et la loi « du double vote » est adoptée le 29 juin 1820 : le quart des électeurs les plus imposés peut désormais voter deux fois, d’abord pour désigner 258 députés à l’arrondissement, puis pour en désigner 172 au département, ce qui révèle les véritables objectifs des ultras. Ces derniers, à travers le ministère Villèle qui parvient au pouvoir la même année, diminuent les impôts afin de réduire le nombre d’électeurs, de 105 586 en 1820 à 88 279 en 1829.
Pourtant, après une première Chambre très favorable aux ultras, les libéraux et le centre constitutionnel gagnent peu à peu du terrain, et Charles X décide de limiter le suffrage au collège départemental, au bénéfice du quart des électeurs les plus riches : les autres électeurs ne seraient là que pour désigner des candidats. Cette tentative de « monopole absolu de la grande fortune » , au mépris de la petite et moyenne bourgeoisie urbaine, déclenche des réactions scandalisées. Le cens, à cette époque, était considéré par les doctrinaires comme Guizot comme la marque de la capacité à raisonner et à comprendre les enjeux politiques : il s’agirait d’une « souveraineté de la raison » , ce qui revient à nier l’idée-même de souveraineté, en lien avec le libéralisme politique.
Le libéral Benjamin Constant défend quant à lui la souveraineté populaire et l’assimile à la volonté générale : c’est là qu’on trouve la gauche. Il souhaite cependant limiter cette souveraineté, au nom des droits de l’individu et pour éviter les abus de pouvoir, ayant fait l’expérience de ceux de l’Assemblée censée être représentative et s’étant arrogée en réalité la souveraineté. La limitation de la souveraineté serait donc le seul moyen d’éviter la tyrannie, en reconnaissant l’existence de droits individuels indépendants. C’est la naissance du libéralisme, car auparavant, toute souveraineté était pensée comme illimitée ; Constant s’approche ici davantage de Montesquieu que de Rousseau. Constant souhaite donc un « pouvoir neutre », en arbitre, pouvant dissoudre les assemblées et destituer les dépositaires du pouvoir exécutif : c’est le seul rôle qu’il souhaite pour la monarchie, qu’il défend donc, alors que les républicains souhaitent une souveraineté absolue du peuple.
Constant est aussi favorable au suffrage censitaire, le richesse étant une « présomption de capacité » , puisqu’un homme fortuné aurait davantage de moyens d’être instruit. Les élus sont tout de même sélectionnés selon un processus « démocratique » , mais par des conditions aristocratiques. Le suffrage n’est alors pas considéré comme un droit, mais une fonction : déterminer l’intérêt général (et non voter pour son intérêt particulier). Dans la pratique, les électeurs censitaires votent pour leurs intérêts : on voit que, sous la Restauration, la question sociale est ainsi complètement évacuée, même par la gauche.
Le régime de la Restauration est ainsi représentatif, mais non parlementaire (ou parlementariste), puisque les gouvernements ne sont pas responsables devant la Chambre des députés ; après 1830, le régime devient parlementaire, et tous les gouvernements mis en minorité au Parlement démissionnent dans les faits. Louis XVIII et Charles X étaient en effet autoritaires, désignaient leurs ministres, et nommaient un Président du Conseil sans se soucier forcément de la majorité de la Chambre. Cela les conduit à affronter cette majorité : Louis XVIII fait ainsi face aux ultras en 1815, qui souhaitent revenir à l’Ancien Régime (par exemple en revenant sur l’acquisition des biens nationaux ou sur le Concordat), en dissolvant la Chambre par pragmatisme. Les ultras étaient donc, par opportunisme, favorables au parlementarisme à cette époque, ce qu’on peut voir chez Châteaubriand par exemple, qui souhaite que le ministère soit issu de la majorité des chambres et applique sa politique – des principes parlementaristes. Les libéraux, ironiquement, soutenait donc le roi, comme les doctrinaires, Royer-Collard parlant de « prérogative royale » .
Bien entendu, lorsqu’en 1830, c’est une Chambre proche de la gauche qui s’oppose au roi Charles X, les doctrinaires et libéraux sont tout d’un coup favorables au parlementarisme, alors que les ultras au gouvernement s’y opposent. Cette fois, la dissolution se termine par un échec pour le roi, dont l’obstination entraîne la chute au cours de la révolution de Juillet, sur les questions du mode de scrutin, de la responsabilité ministérielle et de la liberté de la presse. La gauche favorable à la souveraineté populaire n’avait pas joué de véritable rôle : ce sont les dissensions des royalistes pourtant opposés à la souveraineté du peuple qui ont mené le régime à sa chute.
Sous la monarchie censitaire, la presse est déjà un organe d’opinion, avec une interaction permanente entre journalistes et lecteurs pour ajuster la ligne éditoriale de chaque journal et l’adapter aux attentes des lecteurs. Les journaux permettent ainsi d’exprimer les différents courants d’opinion qui traversent la société, faisant entrer la France dans un « régime d’opinion » pouvant exercer une pression sur le gouvernement, tout comme les assemblées. Les libéraux de l’époque (Guizot, Constant…), et même des ultras comme Chateaubriand, y sont favorables, Guizot parlant même de moyen de gouvernement. Constant y voit quant à lui un progrès de la communication, comme le langage l’avait été. Ainsi, toutes les oppositions au pouvoir, même lorsqu’il s’agit d’ultras, sont favorables à la liberté de la presse. Les libéraux, aussi appelés « indépendants » sous la Restauration, luttent contre les ultras pour cette liberté, notamment en 1827 lorsqu’un projet la limitant fortement est présenté. Cette liberté n’est réellement exercée qu’entre 1819 et 1820 (lois de Serre), puis entre 1828 et 1830 (cette législation étant rétablie). Mais elle entre peu à peu dans les esprits, contrairement à la période napoléonienne. La presse, bien qu’élitiste et restreinte dans sa diffusion par le prix du journal, est largement d’opposition : 49 000 abonnés parisiens pour la presse d’opposition en 1826, contre 14 000 pour la presse ministérielle.
Après les persécutions révolutionnaires contre le catholicisme, ce qui suscite la révolte d’une partie de la paysannerie (notamment en Vendée), Bonaparte met en place le Concordat en 1801 pour apaiser la situation en redonnant une place prépondérante au catholicisme. Les ultras, cependant, ne sont pas satisfaits, s’étant rapprochés du catholicisme durant leur exil, et agissent dans la Chambre au bénéfice de l’Église, par exemple en accroissant le nombre d’évêchés pour revenir à celui de l’Ancien Régime, en améliorant les traitements ecclésiastiques… Charles X se fait lui-même sacrer à Reims en se prosternant devant l’archevêque, avant d’instaurer une loi sur le sacrilège punissant de mort les profanations d’hosties consacrées, ce qui revient à reconnaître la présence réelle de Dieu dans la loi. Chateaubriand et sa fraction d’ultras (les Pointus), ainsi que la gauche et les doctrinaires, s’y opposent farouchement, et la loi, bien que partiellement votée, n’est jamais appliquée.
En retour, comme les persécutions qui avaient suscité un regain de catholicisme, l’anticléricalisme prend de nouveau son essor, et prend pour cible les jésuites, accusées par la presse républicaine et bonapartiste de vouloir dominer le pays. Le comte de Montlosier, pourtant un ultra s’étant opposé à la Constitution civile du clergé, s’oppose à ce tournant clérical, à la Congrégation, aux jésuites et à l’ultramontanisme. La gauche se revigore sur ce thème fondateur pour elle. Les jésuites, accusés d’être des menteurs fomentant de sombres complots et vivant dans la décadence pour corrompre la jeunesse à travers l’éducation jésuite, permettent à la gauche de s’unir sur l’anticléricalisme et le libéralisme réunis, fondements de la gauche moderne structurée autour de la gauche bourgeoise et des milieux populaires. Constant, chez les libéraux, est bien seul à parler de tolérance et de neutralité ; il précède de loin Aristide Briand.
C’est donc à cette époque que les notions actuelles, conçues comme telles, de gauche, centre, et droite voient le jour : indépendants puis libéraux à gauche, doctrinaires ou constitutionnels au centre, et ultras à droite. Il ne s’agit pas de partis constitués comme aujourd’hui, mais plutôt de réunions, de comités, formés pour chaque mouvance de bourgeois. Sous la Restauration s’opposent les royalistes aux libéraux ; le centre bascule régulièrement de l’un à l’autre, étant proche des royalistes de 1816 à 1820 et sous Martignac entre 1828 et 1829, et des libéraux sous Villèle de 1820 à 1827, puis sous le ministère Polignac de 1829 à 1830. Des dissensions existent aussi, à gauche (l’avocat Manuel étant intransigeant) et à droite (avec Agier et Chateaubriand). Mais de manière générale, le centre trop faible pour gouverner seul ne tient pas, et c’est l’alternance qui prévaut, entre défenseurs du pouvoir et de la liberté. Plus le pays est clivé, et plus le centre peut faire office de pivot. Sa distance avec les libéraux parlementaires n’est pas si grande : La Fayette et Constant défendent en effet la Charte, et soutiendront par la suite l’orléanisme plutôt que la République, ayant souvenir de l’expérience de la Terreur et pensant que la liberté doit précéder l’égalité.
La gauche non parlementaire n’a pas la même lecture des événements, et s’insurge régulièrement, notamment à travers des sociétés secrètes, où sont présents étudiants et vétérans de l’armée impériale, nostalgiques d’une légende napoléonienne de gauche. Des complots visent en vain à prendre le pouvoir, par exemple autour de l’avocat Didier à Grenoble en 1816. Cette tactique se poursuivra jusqu’en 1870, avec Blanqui. La Fayette lui-même est à la tête de la Charbonnerie entre 1821 et 1823, une société secrète de gauche visant à prendre le pouvoir, sans résultat. Cette société n’était même pas partisane d’une république démocrate, préférant un « état d’esprit » de liberté, plus ou moins fondé sur la souveraineté du peuple, mais avec peu d’application concrète. Pour ces libéraux, la forme du régime importe moins que le fond, c’est-à-dire la question de la liberté. C’est comme cela que l’on peut interpréter le début de l’essor de la presse sous la Restauration, notamment dans ses dernières années, avec par exemple la participation de Thiers, futur orléaniste, au journal le National, d’opposition très nette sous Charles X. Bien que réactionnaire, la Restauration était aussi moderne, admettant l’individualisme plutôt qu’une société fondée sur les corps sociaux : c’est l’un des acquis de 1789, que le régime soit conservateur ou non. Le libéralisme politique s’implante de plus en plus, et ce sont bien les libéraux conservateurs qui se révoltent en 1830 lorsqu’il est remis en cause par l’autoritarisme de Charles X.
Sous le nouveau régime, la monarchie de Juillet de Louis-Philippe (1830-1848) issu de la révolution de Juillet (après la tentative de Charles X d’annuler les concessions à la Révolution et les élections qu’il vient de perdre), le champ politique parlementaire se recompose. En voici une version simplifiée : on y trouve à droite les légitimistes menés par Berryer (anciens ultras royalistes), qui sont attachés aux intérêts de l’ancienne aristocratie et regrettent la chute de l’ancienne dynastie ; au centre-droit les doctrinaires de Guizot (anciens constitutionnels), incarnant le « parti de la Résistance » convaincu que la révolution de 1830 doit marquer un point d’arrêt dans les réformes politiques et sociales, défendant le nouvel ordre établi ; au centre le « Tiers parti« , animé par Dupin aîné, sorte de Plaine où l’on trouve les députés indécis pouvant se rallier à un camp ou l’autre selon les opportunités personnelles et les sensibilités des députés ; au centre-gauche Thiers et les orléanistes réformistes modérés souhaitant élargir modérément le suffrage et mener une politique étrangère offensive et favorable aux nationalistes des pays subjugués (comme la Belgique par exemple) comme à la gloire nationale ; à gauche, la gauche dynastique d’Odilon Barrot, aussi nommée le « parti du Mouvement » (les anciens indépendants) dont l’objectif est d’élargir fortement le droit de vote et de favoriser l’ascension sociale des classes moyennes ; et, de façon plus marginale encore, la gauche radicale de Garnier-Pagès, proche des républicains et favorable au suffrage universel. Il faut cependant noter que tous ces partis (exceptés les légitimistes, qui sont traditionalistes, et la gauche radicale, proche de ce qu’on pourrait appeler le « radicalisme » , un courant libéral spécifique car républicain et anticlérical) peuvent être rangés dans la catégorie des libéraux, du point de vue philosophique : soutenant tous les intérêts de la bourgeoisie, ils n’ont que très peu d’intérêt pour la question sociale, et ils ne sont pas non plus républicains : attachés avant tout à la croissance économique, à l’exaltation de l’individu, à la souveraineté nationale plutôt que royale, et aux droits de l’homme (en particulier la liberté et le droit de propriété), ils ne se préoccupent pas d’instaurer une démocratie réelle (étant opposés au suffrage universel et à la République) ni de réduire les inégalités de richesse. Les libéraux de gauche sont certes attachés à la souveraineté populaire, mais de façon régulée, et à l’avènement de la Deuxième République, Odilon Barrot lui-même montrera son opposition aux mesures les plus démocratiques et sociales du nouveau régime.
Comme expliqué par Michel Vovelle dans l’ouvrage collectif évoqué, les gauches s’approprient à cette époque l’héritage des Lumières, tandis que les droites ultraroyalistes puis légitimistes les accusent de tous les maux, en premier lieu de la Révolution et de ses conséquences. C’est à cette époque que la légende de Voltaire, l’anticlérical et combattant des causes justes, notamment concernant l’affaire Calas, se propage et marque la culture politique, devenant (rétrospectivement) une figure républicaine, alors qu’il vivait en aristocrate. Même les républicains avancés, en dehors du champ parlementaire, adoptent les Lumières, en les considérant comme une étape nécessaire apportant la raison pour combattre la tradition. Les Lumières s’inscriraient dans l’action du Christ, cette conviction nouvelle illustrant la réconciliation à venir de 1848 entre religion et révolution.
Pour Jacques Julliard, la question sociale prend cependant de l’importance en dehors du champ parlementaire. Louis-Philippe devient roi suite au renversement de Charles X, c’est-à-dire en conséquence du principe de souveraineté du peuple, mais il arrive au pouvoir en tant qu’héritier des Bourbons. Le suffrage censitaire est maintenu, bien qu’assoupli. Le nouveau régime ne condamne plus la Révolution, une amnistie étant prononcée, ce qui bénéficie à la gauche, dont les partisans les plus radicaux de l’égalité se scindent entre républicains, socialistes et classe ouvrière, tous en dehors de la vie politique parlementaire. Cependant, ce sont bien ces forces non parlementaires qui renversent le régime de Charles X, puis maintiennent un état constant d’agitation en 1830 et 1831, notamment contre les ministres de Charles X qui manquent d’être lynchés en décembre 1830. Ce genre d’épisodes se multiplient jusqu’en 1835, avec une révolte éclatant en 1834 à Lyon, puis à Paris, contre la nouvelle loi restreignant la liberté des associations, avant un écrasement de l’insurrection par Thiers. La gauche parlementaire, que représente Thiers selon Jacques Julliard (bien qu’on pourrait le placer au centre-gauche orléaniste), participe donc à la répression de la gauche non parlementaire. Il fait ensuite voter des lois contre la presse en 1835 à la suite d’un attentat contre Louis-Philippe. Les républicains ne sont en effet pas satisfaits du nouveau régime orléaniste, qui veut juste faire appliquer la Charte au bénéfice de la liberté de la presse et de la responsabilité des ministres devant les Assemblées dans un régime d’opinion. Les orléanistes, contrairement aux républicains, ne souhaitaient pas aller au bout de la logique qui menait au suffrage universel et la république, que défendaient pourtant les insurgés de 1830.
La gauche non parlementaire se divise cependant, notamment sur la question sociale. Ainsi, les républicains s’intéressent davantage aux questions institutionnelles et politiques, prônant un changement de régime vers la République, y travaillant au sein de sociétés secrètes ou de clubs politiques comme la Société des droits de l’homme et du citoyen. Les lois restreignent cependant l’influence de cette direction, ce qui affaiblit durablement le mouvement et l’agitation politique républicaine s’amenuise à partir de 1835, les républicains préférant s’intégrer au mouvement pour la réforme électorale, mené par Odilon Barrot qui anime la « gauche dynastique » , c’est-à-dire la gauche libérale soutenant le régime de Louis-Philippe.
Le socialisme dit « utopique » se distingue cependant de ces républicains, et marque l’apparition de la troisième grande catégorie de courants politiques. En effet, si l’Ancien Régime était fondé sur un autoritarisme absolutiste et traditionaliste concevant les êtres humains comme des membres de groupes sociaux plus larges que lui (notamment sa communauté, sa famille, sa profession…), la Révolution était au contraire fondée sur un libéralisme individualiste où chacun dispose de ses propres droits, sans tenir compte de sa condition ni de son milieu. Ce n’est qu’ensuite, à partir des grèves ouvrières de 1827 et des mouvements insurrectionnels et sociaux de Lyon et de Paris en 1834, que le socialisme apparaît, fondé comme le traditionalisme sur des valeurs « holistes » en opposition à l’individualisme : cependant, son originalité réside dans sa défense de l’égalité, non pas seulement des droits, ni même d’un simple partage des richesses (associé au partage des terres dans la France rurale de 1789, avec l’idée d’une société de petits propriétaires égaux et indépendants), mais à travers une mise en commun prenant la forme de services publics qui remplaceraient la propriété individuelle, dans le cadre de l’industrialisation.
Ce socialisme, que nous avons déjà étudié dans un article récent, s’incarne notamment à travers le comte de Saint-Simon (1760-1825), influencé lui-même par les traditionalistes Maistre et Bonald nostalgiques de l’ordre social ancien et de ses valeurs collectives. La modernité de Saint-Simon réside cependant dans son opposition à l’étatisme autoritaire, et son attachement à l’industrie et à la technique qui en fait un précurseur de la technocratie, préférant l’expertise au suffrage. C’est aussi un précurseur du socialisme, par son collectivisme (refusant le primat absolu de l’individu) et son optimisme quant au progrès. Sa préférence pour les élites intellectuelles par rapport aux élites politiques et sociales du pays le distingue cependant des autres socialistes comme Louis Blanc, et des marxistes, qui croient au primat du politique et donc de l’autorité. Partisan de la fin de toute hiérarchie sociale, il précède ainsi Proudhon et l’anarchisme : ses héritiers sont donc paradoxalement technocrates ou libertariens et anarchistes. L’autre personnage représentant le socialisme utopique est Charles Fourier (1772-1837), dont le projet de société est d’utiliser les douze passions fondamentales qu’il décrit chez l’être humain pour regrouper les personnes en phalanstères de 1 620 personnes combinant les différents types de personnalités. Ces travaux pionniers mènent à ce qui deviendra plus tard les structures associatives, là où Saint-Simon est à l’origine de l’organisation moderne et du socialisme de production.
Ces deux figures, sans être elles-mêmes socialistes, inspirent les premiers socialistes, notamment Louis Blanc, qui souhaitait, à travers ses « ateliers sociaux » , nationaliser des entreprises, puis faire élire leurs dirigeants par les travailleurs. Républicain robespierriste mais non violent, c’est un jacobin centralisateur opposant au principe de concurrence commercial, favorable à un suffrage universel tempéré par l’éducation. Mêlant les principes d’organisation et d’association, Louis Blanc veut ainsi mener à la défense de la fraternité, là où la Révolution avait porté l’individualisme et la liberté. Cette fraternité, presque chrétienne, s’illustre en 1848 lors des débuts de la IIe République, sans aucun anticléricalisme. La République de cette époque, après la révolution renversant la monarchie de Juillet en février 1848, est d’inspiration christique, liée à l’idée d’un Dieu d’amour et de justice ; Le prêtre Lamennais, ancien traditionaliste devenu républicain et socialiste, incarne ce courant. Ancêtre des démocrates chrétiens, opposé à l’abolition de la propriété et de la famille, contrairement aux socialistes, il veut néanmoins bâtir une société nouvelle fondée sur le principe d’association. Dans la IIIe République, c’est cependant la gauche anticléricale qui prend l’ascendant sur la gauche spiritualiste, et l’Église ne se réconciliera que progressivement avec la république, par le Ralliement de 1890, la Grande Guerre puis la Résistance.
Déjà en 1830, la révolution est le fait d’ouvriers parisiens élevant des barricades contre le coup de force de Charles X, qui censure la presse et menace donc le travail d’une partie d’entre eux. Les ouvriers présentent avant tout des revendications prolétaires, sociales, liées à leur aspiration à l’autonomie, comme exprimée par les canuts lyonnais, qui veulent vivre librement avec des salaires décents au lieu de voir leur profession centralisée, préférant les sociétés de secours mutuels. Les ouvriers vivent en effet dans des conditions difficiles, avec un travail épuisant et dangereux, sans protections pour indemniser la maladie ou la vieillesse, des enfants travaillant dès l’âge de 8 ans… Médecins, sociologues, urbanistes, qui sont des « praticiens de l’économie sociale » , s’inquiètent davantage de cette situation que les socialistes eux-mêmes, qui sont davantage conceptuels là où les ouvriers font partie de mouvements pratiques et expérimentaux, jusqu’à ce que Marx et Proudhon lient les deux. C’est par tous ces mouvements que l’on peut constater que le social prime de plus en plus sur le politique, alors que la gauche critique désormais l’individualisme, préférant la fraternité, l’association, et l’organisation.
Après la Révolution ayant marqué l’irruption du peuple au sein du champ politique, l’époque napoléonienne puis la Restauration (1799-1830) sont caractérisées par son effacement, jusqu’à son retour en 1830, par exemple par le biais d’associations, d’insurrections et de théories sociales et socialistes, conduisant à l’émergence de forces de gauche non parlementaires. A la Chambre, comme je l’avais mentionné, l’orléanisme de mouvement s’oppose à l’orléanisme de résistance, principalement en 1830 et en 1831, mais la gauche (le Mouvement) demeure modérée, étant simplement parlementariste, tandis que la Résistance affirmait davantage sa prédilection pour l’ordre. Comme l’explique Nicolas Bourguinat, l’orléanisme fait le choix de rompre avec les gauches dès 1832, par la répression des journées parisiennes de juin 1832, après la nomination du ministère Périer en 1831, dont l’objectif est de conserver le nouveau système issu de la révolution de 1830 sans aller plus loin (en particulier concernant le système électoral). Ce sera ensuite Guizot, à partir de 1840, qui incarnera « l’esprit de fermeture satisfaite de l’orléanisme conservateur » , alors qu’il avait lutté pour la liberté de la presse et la limitation de l’arbitraire royal sous la Restauration. Le Mouvement, quant à lui, est représenté par un sixième des députés seulement, derrière Odilon Barrot, même si des nébuleuses comme le centre gauche et le tiers parti (principalement guidés par leurs intérêts personnels) votent parfois avec lui. Seule la gauche radicale de Garnier-Pagès se distingue réellement, créant ainsi un lien entre la gauche parlementaire et la gauche extraparlementaire, prônant une réforme électorale diminuant le cens à 100 francs (par compromis avec la gauche dynastique), alors que les plus radicaux comme Louis Blanc demandent même le suffrage universel et l’organisation du travail.
Comme décrit par Nicolas Bourguinat, les plus révolutionnaires ne croient pas en l’action parlementaire, et fondent des Sociétés, comme la Société des saisons, dont l’objectif est un coup de force pour instaurer la république avec un véritable programme, incluant enseignement primaire gratuit, impôt progressif, réforme de la justice, suffrage universel… en suivant le modèle de la Ière République, avec le monocamérisme et des formes collégiales de pouvoir. L’idée d’un programme social apparaît, mais conduit aussi à la dispersion des forces du républicanisme dans d’autres mouvances, notamment le communisme utopique ou le socialisme organisateur, éloignés de l’idée de République comme État avec un régime représentatif, étant plutôt centrés sur la réforme de la société et des cellules de production.
Le décalage entre les revendications sociales extraparlementaires et la gauche dynastique devient de plus en plus patent ; il éclatera à partir de la révolution de 1848, lorsque le républicanisme ou la question de la réforme électorale ne pourra plus unir ces différentes aspirations. La culture de combat s’opposera alors frontalement à la culture de gouvernement au cours de la IIe République.
Les gauches après les monarchies censitaires : le retour des républicains (1848-1871)
Après trente ans à soutenir le libéralisme, les gauches s’affirment désormais comme républicaines, ce qu’elles resteront jusqu’à aujourd’hui, associant durablement dans l’imaginaire la République et la gauche, jusqu’à ce que les droites se rallient majoritairement à la République à partir des années 1890. Ces gauches cessent dans les faits d’être révolutionnaires, à présent que la république est advenue, hormis l’épisode de la Commune de Paris en 1871 : il n’y a plus eu depuis 1848 de révolution, même si la rhétorique révolutionnaire reste de mise pour des décennies. N’étant plus révolutionnaire dans la pratique, les gauches ne possèdent plus non plus le monopole de la liberté, les droites affirmant leur défense « des libertés » .
Les déceptions des gauches ne surviennent qu’après une phase où la République est d’abord un imaginaire, une philosophie sur laquelle se focalisent les espérances. Dans les faits, la Ière République n’est d’ailleurs jamais appliquée, le gouvernement étant déclaré « révolutionnaire jusqu’à la paix » dès 1792. Les institutions s’étaient régularisées sous le Directoire, avec cependant des coups d’État quasi-annuels, et sous la IIe République, l’expérience n’a duré que trois ans. On trouvait en revanche des éléments républicains, fondés sur l’élection, dans les monarchies censitaires ; et, officiellement, en 1804, Napoléon Ier était à la tête du « gouvernement de la République » : les régimes se recouvrent et se confondent partiellement.
La République, en 1848, n’est pas qu’une institution : c’est une utopie, portant la philosophie de la gauche. En 1848, l’utopie dura près de trois mois, de la révolution du 24 février au 15 mai, lorsque l’extrême gauche tente de renverser l’Assemblée élue le 23 avril. Initialement, la révolution est pacifique, démocrate et humanitaire, portant suffrage universel, abolition de l’esclavage, abolition de la peine de mort politique, liberté de la presse, droit au travail et amitié entre les peuples, afin de fonder un État démocratique. Non violente, la révolution se montre généreuse dans ses accomplissements, dans l’effervescence de la rue et par le travail du gouvernement provisoire où se mêlent républicains modérés et avancés (notamment l’ancien élu de gauche radicale Garnier-Pagès, le républicain avancé Ledru-Rollin et le socialiste Louis Blanc), sous la direction du modéré Lamartine. Cette République, fondée pour Jean-Claude Caron sur la fraternité et l’universalité, échoue cependant, et bien que les fondateurs de la IIIe République appartiendront à une autre génération, elle servira par la suite de référence, comme expérience utile à l’apprentissage politique.
La nouvelle Assemblée, bien qu’en théorie peuplée de républicains (Thiers s’affirmant comme tel), est dominée par le « parti de l’ordre » , où se retrouvent les élus des droites. Ce parti s’oppose vigoureusement aux Ateliers nationaux (des sortes d’emplois aidés, en partie fictifs, au bénéfice des ouvriers) issus de la Commission du Luxembourg présidée par Louis Blanc dont l’objectif est d’aboutir à une première législation sociale, résidant notamment à dix heures la journée de travail à Paris. L’Assemblée pousse la Commission exécutive, nouveau gouvernement mené par le républicain modéré Arago, à dissoudre les Ateliers nationaux le 21 juin, et une insurrection prolétaire s’ensuit le lendemain, dans un conflit sans chef et purement social qui mène à la mort de 4 000 insurgés et à la rupture entre la République de la gauche paysanne et « bourgeoise » et la gauche prolétaire et ouvrière.
En effet, pour Jean-Claude Caron, la question de l’égalité divise à gauche : les modérés comme Lamartime prônent une simple égalité juridique, politique et civique, alors que les radicaux comme Ledru-Rollin veulent d’un contenu social, et que les socialistes comme Louis Blanc veulent aller encore plus loin – et les valeurs de fraternité et de réconciliation ne suffisent pas à transcender ces désaccords. Les sociaux-révolutionnaires, notamment Blanqui et les « rouges » dans leur ensemble, mettent le social au premier plan, et veulent soumettre le pouvoir républicain à un contrôle permanent du peuple : ils préfèrent la souveraineté populaire à la souveraineté nationale, et forment donc des clubs en guise de contre-pouvoir, pour exercer une pression sur le gouvernement, qui cherche quant à lui à se dissocier de l’héritage violent de la Révolution et à plutôt privilégier une atmosphère quasi-religieuse faisant en permanence référence au Christ et sublimant le peuple, l’humanité et la France, la république christianisée devant éviter la guerre civile, la Fraternité liant alors la Liberté et l’Égalité. Les graines de la discorde apparaissent cependant dès mai 1848 : le 15 mai, à la suite des élections défavorables d’avril pour la gauche radicale, une manifestation menée notamment par Louis Blanc tente de prendre le pouvoir en envahissant l’Hôtel de Ville pour intervenir en soutien de la Pologne révoltée, mais le mouvement est tenu en échec et Louis Blanc doit s’exiler.
Ainsi, le social, désormais, divisera la gauche ; et c’est la droite qui en profite, par l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte, candidat du parti de l’ordre soutenu par Thiers et les orléanistes, comme président de la République avec 5 436 000 voix. Les trois droites (orléaniste, légitimiste et bonapartiste) se sont unies et l’ont emporté sur des républicains divisés, abandonnés par les ouvriers (du fait des journées de Juin et de la répression menée par Cavaignac, candidat malheureux à la présidence) et les paysans (victimes de l’augmentation de 45% des impôts en mars 1848).
Jean-Claude Caron explique ainsi que, face à l’exercice du pouvoir, alors même qu’une partie de la gauche radicale trouve le succès lors des élections de mai 1849, la République opère un glissement conservateur, et la gauche de gouvernement, originellement révolutionnaire puis réformiste (suffrage universel masculin, abolition de l’esclavage et de la peine de mort politique, liberté de la presse et d’association, ateliers nationaux, limitation de la durée journalière du travail), puis stabilisateur, face à la crise financière, économique et monétaire. Des hommes de la tendance du journal Le National (républicain modéré et libéral) entrent à la Commission exécutive dès 1848, et la question sociale est brutalement résolue par la répression des émeutes de juin, survenues à la suite de la fermeture des ateliers nationaux (décidée après la manifestation du 15 mai) : désormais, une politique conservatrice est instaurée, la journée de travail étant par exemple portée à douze heures alors qu’à Paris la IIe République avait instauré la journée de dix heures. C’est la fin de la République sociale et le début de la marginalisation de la gauche socialiste, Louis Blanc s’exilant. Cet événement marque aussi le passage de revendications politiques (le soutien à la Pologne) à des revendications sociales (liées à la fermeture des ateliers nationaux). La gauche de gouvernement, représentée par Cavaignac, est ensuite évincée par Bonaparte, qui opère un nouveau virage à droite en s’alliant avec le parti de l’ordre.
Les élections du 13 mai 1849 mènent 75 candidats républicains modérés à l’Assemblée législative, 500 candidats du parti de l’ordre (monarchiste, réactionnaire et catholique), et 180 candidats de la gauche radicale, républicaine et sociale (menée par Ledru-Rollin). Les droites peuvent alors mener une politique conservatrice, avec la loi Falloux du 15 mars 1850 établissant la liberté de l’enseignement sous contrôle du clergé, celle du 31 mars 1850 rendant obligatoire une sédentarité de trois ans pour voter dans sa commune (éliminant un tiers des électeurs, c’est-à-dire tous les journaliers et compagnons du Tour de France, dans une logique purement orléaniste), et celle du 16 juillet 1850 contre la presse par le rétablissement du cautionnement.
Jean-Claude Caron note que les progrès de la gauche radicale (à présent que la gauche de gouvernement est évincée) laissent envisager une victoire dès les élections législatives et présidentielles de 1852, plutôt que de passer par des mouvements insurrectionnels comme celui du 13 juin 1849 par Ledru-Rollin. La gauche républicaine et sociale politise les campagnes, et c’est en partie pour cela que Thiers fait voter la fin du suffrage universel masculin.
Le président, par son coup d’État du 2 décembre 1851, met un terme à cette politique orléaniste et à l’éventualité d’une prise de pouvoir de la gauche radicale, mais rapproche paradoxalement Thiers de la gauche parlementaire : l’orléanisme, face à un pouvoir lui-même conservateur socialement et partisan de l’ordre, redevient libéral sous l’égide de Thiers qui défend en 1864 les libertés nécessaires. Pour Jean-Claude Caron, le coup d’État, en mettant un terme à la République, classe définitivement le bonapartisme à droite, alors qu’il pouvait être perçu comme de gauche sous les monarchies censitaires. Les gauches radicales, en dehors du champ parlementaire, résistent, notamment dans les campagnes, mais en vain. Ainsi, la classe moyenne de la bourgeoisie avait mené la révolution de 1848, avant de s’allier aux conservateurs, puis de retourner dans l’opposition. L’Église, qui soutient le coup d’État, rallie le parti de l’ordre, coupant la religion républicaine de la référence au Christ, et relançant l’anticléricalisme de gauche.
Sylvie Aprile revient ensuite sur la situation de la gauche sous le Second Empire. Après la répression de la résistance au coup d’État de 1851, caractérisée par une insurrection des campagnes avec 70 000 insurgés dont 60% de paysans, le pouvoir bonapartiste utilise ces révoltes pour justifier son coup de force et la menace du « spectre rouge » socialiste. La répression est telle que toute action républicaine légale est par la suite impossible, menant à l’essor des luttes clandestines et des conspirations, une menace souvent exagérée par les autorités pour justifier leur action répressive. Face à la fragilité du régime, fondé sur la personne de Napoléon III sans héritier jusqu’en 1856, les attentats se multiplient, notamment celui d’Orsini en 1858 (qui mène à la loi de sûreté générale), et d’autres également liés à des révolutionnaires internationaux appartenant à une nébuleuse européenne.
L’extrême gauche, en particulier la mouvance menée par Blanqui, cherche à prendre le pouvoir par des coups de force, puis à appliquer des réformes radicales sur l’impôt, la fin de la propriété individuelle… dans le même temps, les ouvriers veulent former un parti ouvrier, ce qui représente une nouveauté symbolisant leur volonté d’émancipation politique et sociale, même par rapport au reste de la gauche. Napoléon III, sensible à cette question, permet le développement de sociétés de secours mutuel, puis accorde le droit de grève en 1864, tout en encourageant les tentatives de représentation politique des ouvriers, distincts des républicains et libéraux. L’Association internationale des travailleurs (AIT) est ainsi fondée en 1864, avec un siège à Londres. Mais les grèves se multipliant, le pouvoir impérial marque son soutien aux patrons, et la gauche ouvrière se détache du bonapartisme.
Sylvie Aprile aborde aussi la question de la gauche modérée. Les républicains reviennent sur la scène politique à partir de 1857 : cette année et en 1858, cinq républicains sont élus et prêtent serment de fidélité à Napoléon III pour pouvoir siéger. Les idées foisonnent à nouveau, d’autant plus qu’à partir de 1860, les élus peuvent à nouveau envoyer une « adresse » à l’Empereur au début de chaque session. Le renouvellement intellectuel s’inscrit dans un positivisme transformé, adhérant à la Révolution et à la démocratie populaire plutôt qu’à une société hiérarchisée et gouvernée par des élites naturelles : s’inspirant plutôt de Littré, les républicains se préoccupent de l’opinion (pour agir en fonction des consensus, par « opportunisme » ), favorisent le recours à l’expérience, et s’affirment anticléricaux. Cela devient le programme de la gauche. L’opposition se renouvelle par ailleurs dans de nouveaux lieux, échappant à la surveillance policière, en particulier les salons, qui peuvent désormais être républicains, notamment pour celui de Daniel Stern (comtesse d’Agoult). Étudiants et artistes se distinguent dans le même temps dans leur opposition au régime, d’autant plus à la suite de la loi sur la presse de 1868 permettant la critique du gouvernement (avec par exemple le journal La Lanterne). Le programme de Belleville, qui fera référence sous la IIIe République, s’élabore alors sous l’égide de Gambetta : suffrage universel à l’échelle des communes, pour les députés et les fonctionnaires publics, il demande également la liberté de réunion et d’association, des réformes sociales, religieuses et militaires (impliquant la suppression des armées permanentes). Le régime, tentant de se renouveler par ses réformes, tombe cependant du fait de facteurs extérieurs, liés à la capture de Napoléon III lors de la guerre franco-prussienne de 1870.
Pour Jacques Julliard, le Second Empire peut en réalité être considéré comme « une phase préparatoire » à la République : le suffrage universel est rétabli, après avoir été aboli par la République elle-même sous l’action des bourgeois orléanistes et des catholiques conservateurs. Sous le Second Empire, la gauche bourgeoise peut se réconcilier avec la gauche populaire, jusqu’à leur retour conjoint en 1870. La période leur avait permis de « rêver » une nouvelle fois la République idéale, à travers deux modèles : le progrès selon Condorcet, fondé sur le progrès de l’esprit humain et de ses réalisations matérielles, et le progrès selon Auguste Comte, qui décrit trois états successifs pour la société suivant un « principe de nécessité » , déterministe. Là où la vision de Condorcet impliquait un volontarisme donnant une impulsion politique, celle de Comte n’évoquait qu’un accompagnement passif du progrès.
Sous le Second Empire, les philosophes Renouvier et Vacherot adhèrent à la première vision, et Littré et Ferry à la seconde. Par exemple, Renouvier considère que le progrès est possible (non nécessaire) par l’action de la liberté, pour sortir de la nature, se révélant comme un « kantien pessimiste » , conscient de la réalité du mal, prudent face à la souveraineté, préférant le liberté. Ferry, dans la lignée du comtisme, est bien positiviste, mettant l’accent dans sa politique sur l’ordre et le progrès. Il valorise cependant l’éducation, en cohérence à la fois avec le comtisme et la philosophie de Condorcet. Comte se distingue en soutenant le coup d’État de 1851, n’étant pas un partisan de l’égalité ni de la démocratie, préférant l’ordre. Ferry, au contraire s’inspire donc à la fois des Lumières, du positivisme et du kantisme, mais dans son action politique, le volontarisme des Lumières l’emporte.
Jacques Julliard revient ensuite sur la Commune de Paris. En 1871, les couches moyennes de la classe ouvrière et des artisans mènent leur propre révolte, avec la Commune de Paris. Durant cette tentative de deux mois, aucune figure principale n’émerge pour prendre la tête du soulèvement, d’inspiration libertaire, dans la pratique proche de la démocratie directe, sans aucun autoritarisme. Socialement, on trouve 33 ouvriers sur 86 élus à l’assemblée de la Commune, ainsi que 14 employés, 12 journalistes, 5 petits patrons, et 22 hommes issus des professions libérales : les travailleurs manuels sont majoritaires. La Commune est ainsi prolétarienne, non socialiste, et se distingue ainsi entre tous les régimes par son rejet de l’autorité, au cœur de la bourgeoisie tant capitaliste que socialiste. La Commune est proclamée comme organisation décentralisée et fédéraliste, en réplique au gouvernement bourgeois autoritaire de Thiers. Préférant comme le prône l’anarchiste Proudhon les activistes et l’action directe au système représentatif, la Commune n’a pas d’idéal national unitaire. Elle reprend des revendications proudhoniennes, notamment l’association, et des revendications républicaines comme la liberté de presse et l’élection des fonctionnaires, l’instruction laïque, gratuite et universelle, l’assurance contre les risques sociaux… Elle n’était pas socialiste au sens classique (ne souhaitant pas la socialisation de la propriété), mais elle veut étendre les services publics, et généraliser en réalité la propriété. Les communards veulent organiser le travail par l’intermédiaire des ouvriers, non confier cette organisation à l’État, s’inspirant de Proudhon davantage que de Marx et du socialisme autoritaire et policier.
Selon Jacques Rougerie, la Commune est en effet distincte même des plus radicaux des républicains, représentant une gauche ouvrière et révolutionnaire ; après la répression, les socialistes et libertaires valorisent d’ailleurs cette mémoire communarde, récupérée par la SFIO à partir de 1908. Marx, à la suite de cette expérience, amende son projet communiste étatique, considérant que la Commune démontre que la classe ouvrière ne doit pas s’emparer des structures étatiques mais plutôt instaurer une dictature du prolétariat en rendant révocable ses propres fonctionnaires. Dans la pratique, les marxistes reviendront cependant à l’idée de s’emparer de l’appareil d’État.
En effet, là où le Manifeste du parti communiste avait pour objectif la prise de contrôle de l’appareil étatique, la Commune souhaitait le briser en abolissant l’armée permanente et en instaurant la démocratie directe. Cependant, étant donné le contexte de guerre, des mesures comme l’affirmation d’un pouvoir policier sont mises en place. Globalement, la Commune est cependant l’anti-Empire, incarnant la forme utopique de la République, conciliant l’utopie humanitaire de la révolution de février 1848 et l’utopie socialiste des émeutes de juin, souhaitant donc étendre le suffrage universel, garantir les libertés, séparer l’Église et l’État… ainsi que proposé dans le programme de Belleville de Gambetta en 1869. Comme l’explique Jacques Rougerie, la Commune affirme le contrôle permanent des fonctionnaires et magistrats par la population, la participation de cette dernière aux réformes administratives et économiques, l’universalisation à venir du pouvoir et de la propriété, l’union libre des initiatives locales en vue du bien commun… Dans l’objectif d’aboutir à une souveraineté complète du peuple, et à une République démocratique et sociale. Il s’agit, en réalité, de l’aboutissement de la réflexion sur la République développée sous le Second Empire, Proudhon plaçant ainsi la souveraineté dans l’individu. L’objectif est donc pour les Communards « la fin de la mise en tutelle du peuple » .
L’extrême gauche montre donc ici son lien avec les plus radicaux des républicains. Les républicains modérés, quant à eux, veulent écraser la Commune, et la IIIe République se développe alors comme bourgeoise et conservatrice, même avec les radicaux et le solidarisme de Léon Bourgeois : la question laïque permet de faire oublier la question sociale. Le Parti radical est fondé sur cette ambivalence républicaine, bénéficiant de l’absence d’un parti social modéré qui aurait permis l’intégration sociale des ouvriers.
L’utopie prend fin avec la Commune, tout comme l’insurrectionalisme de Blanqui par exemple, et Édouard Vaillant, élu de l’Assemblée communale et son héritier, préfère se rapprocher du marxisme et rapprocher Guesde et Jaurès. Chef du Parti ouvrier à partir de 1880, Guesde rivalise avec Jaurès à la tête du socialisme, s’inscrivant dans le marxisme doctrinal choisissant la lutte électorale dans le court terme (sans participer aux gouvernements « bourgeois » ) et la révolution dans le moyen terme, stratégie en désaccord avec l’insurrectionnalisme de la Commune. Cette dernière influence fortement le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) : préférant l’action syndicale à l’action politique, il considère dès lors que la conquête des pouvoirs publics n’est pas la bonne solution, menant à la guerre civile ou à la dictature révolutionnaire, même si les syndicalistes persistent dans l’attachement à l’autonomie ouvrière et au fédéralisme, à la démocratie directe, aux minorités agissantes… L’expérience de la Commune est ainsi à l’origine du socialisme, pensé sur la base de la négation de la Commune.
La gauche en pratique : la République (1871-1899)
Ce sont les modérés comme Jules Ferry qui fondent la République, à une époque où celle-ci reste impopulaire du fait de l’impôt des 45 centimes et des journées de juin 1848. Ce sont donc les conservateurs qui l’emportent aux élections de février 1871, avec 400 élus contre 150 pour les républicains et 30 pour les bonapartistes : il s’agit avant tout d’un vote pour la paix avec l’Allemagne. La République est instaurée notamment par l’action de Thiers et Gambetta, qui mettent en place des institutions républicaines alors qu’une restauration monarchique était possible. A cette époque, la République, c’est la gauche, l’émancipation citoyenne de l’individu par les libertés individuelles et le suffrage universel : des principes pérennisés en France par la IIIe République, exceptée la parenthèse vichyste (1940-1944).
Au niveau des institutions, le pouvoir législatif est prépondérant et émane seul du peuple, la République se méfiant du pouvoir exécutif associé au système monarchique, d’autant plus que le seul président de la République, élu sous la IIe République au suffrage universel, avait déclenché un coup d’État puis restauré l’Empire. Comme sous le Second Empire, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, en particulier pour élire les députés. En 1875, les monarchistes et conservateurs souhaitent de nouveau un pouvoir exécutif fort, contre l’opinion des républicains : finalement, la présidence de la République est maintenue, mais est élue par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale plutôt que par le peuple, avec des pouvoirs cependant d’ampleur, ayant l’initiative des lois et pouvant dissoudre la Chambre, étant enfin le chef du gouvernement (le président du Conseil n’existant pas dans la loi de 1875). La « constitution Grévy » , c’est-à-dire la pratique du pouvoir par le président (républicain modéré « opportuniste » ) de la République Jules Grévy de 1879 à 1888, Le Sénat est élu par un collège de notables formé principalement par des délégués de conseillers municipaux des communes rurales, généralement conservateurs, tandis que le scrutin uninominal d’arrondissement à deux tours favorise les notables locaux : les institutions sont donc conservatrices, écartant dans l’idée la souveraineté du peuple.
Pour Gilles Candar, la dernière période que nous étudierons dans cet article, entre 1871 et 1899, correspond à un tournant décisif : l’enracinement des institutions républicaines et la victoire des gauches, consacrée par la formation du gouvernement de « défense républicaine » de Waldeck-Rousseau le 22 juin 1899, trois ans avant la victoire du bloc des gauches. La République et la gauche partent de loin : en 1871, les conservateurs dominent l’Assemblée nationale, et souhaitent restaurer la monarchie, face à une gauche républicaine n’occupant qu’un tiers des sièges. Cependant, elle peut compter sur l’appui, outre des « républicains de la veille » souhaitant des réformes politiques et sociales menant à la démocratie, des « républicains de raison« , comme Thiers au centre gauche et d’anciens orléanistes qui estiment la République nécessaire pour ses institutions menant une nouvelle stabilité. Au centre, des réunions nébuleuses se forment en effet en fonction des votes et des circonstances, notamment au centre-gauche qui soutient l’amendement Wallon de 1875 officialisant l’instauration de la République. A gauche, à l’Assemblée constituante de 1871, on trouve la Gauche républicaine de Jules Ferry et de Jules Grévy, ainsi que l’Union républicaine de Gambetta. Tous sont bien républicains, n’étant opposés que par la radicalité de leur volonté de réforme constitutionnelle et de laïcité : il s’agit de ceux qu’on nomme les « républicains opportunistes » , distincts de la droite demeurant monarchiste, et des radicaux (puis socialistes à partir de 1893) qui veulent légiférer sur la question sociale. Tous les modérés adhèrent cependant à une stratégie de ralliement du centre gauche et des orléanistes en valorisant des valeurs qui leur sont chères, en particulier la paix, le travail et l’ordre, afin de les convertir en républicains. Ils remportent ainsi rapidement des victoires, avec environ 55% des voix en février-mars 1876 lors des élections législatives, pour 360 députés contre 160 pour les conservateurs.
En effet, Thiers souhaitait surtout l’hégémonie sociale de la bourgeoisie, ce qui est le cœur de l’orléanisme, qui peut s’incarner dans une monarchie comme dans une république : selon Jacques Julliard, « la droite représente des intérêts, la gauche des idées, l’extrême droite et l’extrême gauche des passions« , et en l’occurrence, les intérêts bourgeois unissaient les orléanistes et les républicains conservateurs. Thiers devient donc président entre 1871 et 1873, entre une majorité monarchiste et une gauche républicaine dont il se rapproche, les monarchistes se méfiant de son influence. Gambetta, jusque-là belliciste, saisit cette opportunité et présente la république comme un régime d’ordre, fondé sur « une couche sociale nouvelle » : les commerçants, artisans, employés, médecins et instituteurs, qui s’ajoutent à la bourgeoisie de la monarchie de Juillet.
Les monarchistes poussent Thiers à démissionner, mais Gambetta poursuit cette rhétorique de modération, faisant voter des lois constitutionnelles républicaines, et donnant le clergé comme ennemi commun à la gauche dès 1877. Cette année-là, le président monarchiste Mac-Mahon le 16 mai 1877, pousse à la démission le Président du Conseil Jules Simon, un républicain modéré nommé la même année, en raison d’un désaccord sur l’attitude à adopter concernant les manifestations ultramontaines. C’est le début d’une crise institutionnelle. Le Président dissout l’Assemblée qui souhaite contrôler le gouvernement et préserver la République : les républicains l’emportent contre lui lors des nouvelles élections, ce qui transforme dans les faits la IIIe République en régime parlementaire, plus aucun président de la IIIe République n’usant ensuite du droit de dissolution. Mac-Mahon, après la victoire des républicains aux élections sénatoriales démissionne en janvier 1879, remplacé par le républicain parlementariste Jules Grévy, qui renonce à son droit de dissolution et inaugure une pratique du pouvoir plus distanciée et réservée pour le Président de la République, communément appelée la « constitution Grévy » : c’est ce qu’on appelle aujourd’hui le parlementarisme absolu. Waddington, une personnalité de second plan, obtient la présidence du Conseil pour éviter l’ascension de Gambetta : la gauche entame sa tradition de résistance aux fortes personnalités, préférant dès lors la médiocrité, mais aussi l’instabilité ministérielle, un gouvernement durant en moyenne huit mois sous la IIIe République, avec parfois des ministères ne durant que deux ou trois jours.
Les républicains sont alors au pouvoir, et pour Michel Vovelle, c’est le début d’une adhésion illimitée aux Lumières : dès 1878, on célèbre le centenaire de la mort de Voltaire, et Jean-Jacques Rousseau est lui aussi commémoré lors d’une fête le 14 juillet, devenu jour de fête nationale, afin de célébrer la Révolution et la libre pensée, à l’initiative du conseil municipal de Paris. La Marseillaise devient aussi l’hymne national, tandis que l’on amnistie les Communards. Victor Hugo, en cette occasion, compare Voltaire à Jésus, pour ses combats contre les injustices. Les Lumières s’intègrent ainsi à un « nouvel évangile républicain », Hugo affirmant la filiation directe entre les Lumières, la Révolution, et la IIIe République – les différences entre les Lumières sont à partir de là abolies, comme la part sombre de la Révolution, admise comme un bloc : c’est le début d’une religion civile républicaine, associant libéralisme anticlérical (Voltaire) et « populisme socialisant » (Rousseau), même si l’extrême-gauche est plus réticente. Selon Gilles Candar et François Furet, c’est à partir de là que la Révolution s’achève véritablement, avec le triomphe définitif de ses principes, confirmés par les élections législatives de 1881 qui voient les forces conservatrices réduites à moins de cent élus.
Les libertés publiques sont alors garanties par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion sans autorisation préalable, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sans dispositions restrictives (autorisation préalable, droit de timbre et cautionnement) et avec peu de délits de presse (ce qui permet l’avènement d’un régime d’opinion), et la loi Waldeck-Rousseau de 1884 sur la liberté d’association au sein de syndicats professionnels, puis pour toutes les activités sociales en 1901. Le droit au divorce est aussi instauré en 1884. Les conseils municipaux, enfin, sont également élus au suffrage universel à partir de 1882, même si le système politique républicain reste jacobin, étant méfiant de l’autonomie locale.
L’éducation retient particulièrement l’attention de la gauche de gouvernement. La République considère en effet que l’école est une « religion de salut » qui permet de réguler le suffrage universel grâce à la culture et la raison, afin d’éviter le triomphe d’opinions conservatrices et cléricales. La politique éducative républicaine prend dès lors un caractère militant, dont l’objectif est de rallier les « forces populaires, paysannes, ouvrières et petites-bourgeoises » à la République. L’école française existait cependant dès l’Ancien Régime et même depuis le XVIe siècle, à la demande de la société elle-même, notamment dans le Nord, dans les villes et pour les hommes. Les jésuites forment eux-mêmes l’élite nationale, l’Église souhaitant par ailleurs utiliser l’éducation pour sauvegarder la religion.
A partir de la loi Guizot de 1833, toute commune de plus de 500 habitants doit posséder une école primaire, accélérant le processus dans l’objectif de protéger l’ordre social. Chaque mouvance, ainsi, veut utiliser l’éducation à ses propres fins. Ainsi, même avant les lois scolaires de 1881-1882, le nombre d’illettrés chez les hommes atteint moins de 20% du total, 25% chez les femmes. La différence est que Jules Ferry transforme l’école en école républicaine, tout en faisant techniquement fonctionner les écoles dans de bonnes conditions, avec des maîtres formés dans les écoles normales, perfectionnant les lois précédentes et régularisant la scolarité effective de 6 à 13 ans. L’école est désormais gratuite selon la loi du 16 juin 1881, ce qui permet l’obligation par la loi du 28 mars 1882, et enfin la neutralité religieuse, donc l’émancipation vis-à-vis de l’Église.
L’école devient donc un champ de bataille, les républicains souhaitant en faire le creuset des futurs républicains, alors que l’Église veut l’utiliser pour renforcer la religion : les « droits de l’homme » s’opposent aux « droits de Dieu » proclamés par Bonald sous la Restauration, la raison et l’esprit critique à l’autorité et au fidéisme. Les conservateurs dans leur ensemble, certains sans opinions religieuses, sont d’accord avec les catholiques, par souci de l’ordre social et des intérêts bourgeois. Les républicains, notamment Ferry, veulent donc éradiquer les écoles jésuites, qui soutiennent la Contre-Révolution, afin d’éviter la constitution de deux jeunesses opposées mettant en péril l’unité de la nation, clef de voûte de la République, là où des régimes plus démocratiques tolèrent le pluralisme politique : les jésuites sont ainsi expulsés par décret, mais un compromis pédagogique finit par être imposé pour concilier catholicisme et République.
La gauche triomphante se cristallise à cette époque, entre la victoire de 1877 et le ministère Méline de 1896 soutenu par la droite ralliée à la République. Des groupes parlementaires se forment dès 1871 comme nous l’avons vu, avec la Gauche républicaine de Ferry et l’Union républicaine de Gambetta, plus radical et moins bourgeois, moins possédant, et moins instruit. A partir des grandes réformes républicaines citées, les gauches se recomposent : alors que les républicains modérés menés par Ferry (Président du Conseil à deux reprises sous la présidence de Jules Grévy entre 1879 et 1887) ont accompli leurs objectifs institutionnels et politiques, un clivage nouveau fracture le champ politique, cette fois au sein des républicains (de moins en moins contestés par les droites).
Ainsi, selon Gilles Candar, l’extrême gauche radicale parlementaire ainsi que les ouvriers, socialistes et anarchistes contestent la politique économique libérale du gouvernement républicain modéré, qui adhère désormais pleinement à la culture de gouvernement et à une forme de conservatisme social. De plus en plus, le clivage gauche-droite s’opère non sur la question du régime, mais sur la question sociale : les républicains modérés, pourtant historiquement de gauche, sont rejetés progressivement à droite du champ politique, tandis que les droites se rallient à la République. Ce que Gilles Candar appelle l’extrême gauche renvoie aux radicaux, soutenus par les villes et les classes populaires, et menés par Georges Clemenceau, dans l’opposition dès 1881. En effet, ce dernier souhaite des institutions plus républicaines, notamment la suppression du Sénat et de la présidence de la République, ainsi que la décentralisation ; il critique aussi avec virulence la politique coloniale ferryste pour son coût et ses victimes chez les soldats français ; et, enfin, il demande une intervention de l’État dans l’économie pour corriger les lois du marché, réduire la durée du travail, mettre en place des retraites, une réforme de l’impôt, lutter contre le monde de la finance par des nationalisations (notamment des compagnies de chemin de fer et de la Banque de France…). Ces demandes se rapprochent des positions socialistes, tout en restant libérales. Cette proximité mène à la fondation de l’Alliance socialiste républicaine en 1881, avec une ligne « radicale-socialiste » . Cependant, les élections de 1885, qui contraignent une alliance entre républicains de gouvernement et radicaux pour avoir la majorité, révèlent que les positions de Clemenceau, qui accepte cette alliance, demeure un libéral croyant au progrès général par le progrès de chacun.
La gauche de gouvernement, qui jusque-là favorisait le scrutin de liste, adhère à partir des élections de 1889 au scrutin d’arrondissement, face à la menace boulangiste : ce scrutin favorise en effet la ruralité et la petite bourgeoisie, la paysannerie rurale devenant dès lors le visage de la République, qui avait été sous le Second Empire ouvrière et urbaine. La République s’imbibe ainsi de conservatisme, et d’un parlementarisme strict préférant un gouvernement faible et protectionniste, traits distinctifs de la gauche de cette époque, alors que les droites souhaitent renforcer le pouvoir exécutif. Des républicains souhaitent cependant équilibrer les pouvoirs : Gambetta, Ferry, Clemenceau, Poincaré, puis Tardieu et Blum durant l’entre-deux guerres, Mendès-France, et enfin le général de Gaulle. Tous veulent mettre un terme à l’instabilité gouvernementale et l’impuissance du pouvoir, qui manque de continuité et de réactivité. En effet, dans la pratique, la réaction à des événements imprévus constitue la part essentielle de l’activité gouvernementale, rendant nécessaire l’autorité personnelle du chef, dont le rôle ne peut pas être que la simple application des lois. Ce chef, davantage que les élus parlementaires, doit gérer les attentes de la population, et peut donc mieux la représenter. Ferry défend donc, en 1879, la proposition de Charles Floquet de supprimer le droit de dissolution : il considère que l’exécutif doit rester un pouvoir autonome. A gauche, leaders et députés s’opposent ainsi autour du même clivage qui sépare traditionnellement la gauche et la droite.
Face au conservatisme social révélé des républicains de gouvernement et même des radicaux, d’autres mouvements prennent leur essor. Après les ouvriers au cours des années 1870, ce sont les organisations socialistes durant les années 1880 qui appellent à un changement de société, et enfin le socialisme en tant que force politique après 1893. Durant cette période, le congrès ouvrier de 1879 à Marseille se proclame socialiste. Il permet l’adhésion à des thèses collectivistes et la fondation de la Fédération des travailleurs socialistes de France (FTS), dominée par les guesdistes et un socialisme marxiste. De nombreuses scissions mènent à la formation d’autres partis socialistes, confirmant cette tendance de la gauche à la scission : Paul Brousse mène le socialisme municipal des « possibilistes » à la FTS, alors que Jean Allemane fonde le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (POSR) en soutenant la grève générale, alors que d’anciens blanquistes et communards marxistes et conspirateurs fondent le Comité révolutionnaire central (CRC) avec Édouard Vaillant. Maurice Agulhon, dans l’ouvrage collectif mentionné, affirme ainsi une tripartition entre droite, gauche, et Révolution, cette dernière pouvant être attachée à une gauche « extrême » , celle-là même que Julliard qualifiait sans doute de janséniste : cette recherche de pureté, déjà, favorisais les divisions à gauche. Plutôt que de refuser la participation au système parlementaire, les socialistes, bien que divisés, choisissent de jouer le jeu des élections, Louis Blanc étant notamment élu en 1881 aux côtés d’un autre député socialiste.
Cependant, le boulangisme, du nom du général Boulanger (populaire ministre des Armées) à la tête du mouvement vient perturber cette recomposition des gauches (et des droites). Le boulangisme, selon Jacques Julliard, symbolise l’insatisfaction des milieux populaires face à l’impopularité du régime parlementaire embourbé dans l’instabilité ministérielle : des éléments des conservateurs, bonapartistes et de l’extrême gauche radicale se retrouvent ainsi dans le boulangisme soutenu par les classes populaires urbaines, alors que les républicains modérés se reposent sur la province rurale. Le boulangisme réclame en 1888-1889, au cœur de la crise, un triptyque simple et vague : « Dissolution, Constituante, Révision » , concentrant les critiques sur les institutions et les scandales, préférant un régime plébiscitaire à un régime parlementaire.
C’est pour cela que le scrutin d’arrondissement est rétabli, ce qui permet à la République de sortir de la crise avec 55% des suffrages environ en 1889, alors que les boulangistes n’obtiennent qu’une quarantaine d’élus. A cette occasion, selon Julliard, les radicaux s’autonomisent et deviennent un parti de gouvernement (confirmant la tendance de 1885), après s’être opposés aux concessions institutionnels des « opportunistes » et au colonialisme de Ferry : ils font eux-mêmes des concessions, se ralliant aux milieux ruraux et à la petite bourgeoisie des campagnes après être nés dans les villes, devenant de plus en plus militaristes, et favorables au Sénat auquel ils étaient hostiles. Les élections de 1889, en effet, sont surtout une victoire pour les radicaux « assagis » selon Gilles Candar, alors que la ligne de Clemenceau, plus radicale, est marginalisée. En effet, la crise conforte les républicains de gouvernement, puisque les radicaux sont accusés d’avoir nourri le boulangisme par leurs critiques institutionnelles. Certains socialistes, notamment les partisans de Paul Brousse (les possibilistes, dont la stratégie est de fractionner leurs objectifs pour les rendre possibles), ont rallié les républicains de gouvernement pour s’opposer au boulangisme, ce qui affaiblit leur crédit révolutionnaire. D’autres socialistes ont rallié le boulangisme, par opposition à la République libérale, mais cette alliance éphémère et contre-nature (le socialisme français aspirant en permanence à la République sociale) ne dure pas.
Alors que l’évolution des années 1880 menait à distinguer républicains de gouvernement, coupés de la gauche, et une gauche sociale et démocratique inspirée par les radicaux et socialistes, le boulangisme contribue à la recomposition du champ politique. Une éphémère Union républicaine se reforme alors en 1889. Cependant, le scandale du canal du Panama éclate fin 1892, illustrant la collusion entre le personnel politique républicain et les milieux d’affaires, ce qui accroit l’impopularité du régime, sans menacer pour autant la République, qui apparaît sans alternative. Gilles Candar note que le régime s’attache à l’ordre et à la rigueur sociale face aux mouvements ouvriers, au moment où les catholiques, sous l’impulsion de Léon XIII et de l’archevêque d’Alger et de Carthage et cardinal Lavigerie, se rallient à la République en 1893.
A la même époque, les élus socialistes de 1893 se déclareront indépendants, et sont plus de 20, menés en particulier par Alexandre Millerand et René Viviani, fondateurs de la Fédération républicaine socialiste de la Seine, qui est modérée et gouvernementale. Millerand rejoint ainsi le gouvernement de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau en 1899, inaugurant le débat de la participation socialiste aux gouvernements bourgeois. Quoi qu’il en soit, les ouvriers et les employés se joignent au débat républicain.
Plus à gauche encore, les libertaires contribuent à la recomposition du champ politique : ils refusent le principe des élections, étant inspirés par Proudhon, opposé au principe d’autorité et s’affirmant dans la Ière Internationale en rivalité avec le marxisme. Hostiles au parlementarisme, les anarchistes mènent des attentats individuels au cours des années 1890, principalement entre 1892 et 1894, ce qui mène à l’adoption de « lois scélérates » réprimant l’anarchisme. Ces vains attentats mènent certains anarchistes à se tourner vers le syndicalisme, passant de l’action individuelle à l’action de masse sous l’influence de Kropotkine : le syndicalisme révolutionnaire s’incarne ainsi dans la CGT, dont l’opposition avec le parti socialiste du début du XXe siècle retranscrit celle entre anarchistes et socialistes selon Julliard.
Ainsi, à cette époque, les attentats anarchistes et les difficultés sociales tournent le régime vers la droite, en oubliant le progrès social et la fraternité républicaine : c’est « l’esprit nouveau » évoqué par le ministre de l’Instruction publique Eugène Spuller dans un discours de 1894. Même si la droite monarchiste s’effondre, les gouvernements suivants n’apparaissent pas comme étant « de gauche » au sens où on l’entend désormais à cette époque. Ainsi, de 1892 à 1898, et notamment avec le gouvernement Méline (mené par un « opportuniste » , républicain de gouvernement opposé historiquement à Clemenceau) de 1896 à 1898, des ministères de centre droit (républicains mais libéraux, qui se désignent désormais « progressistes » plutôt qu’opportunistes) opposés à la gauche radicale gouvernent la France. Ces gouvernements sont formés sous les présidences de Casimir-Périer en 1894, lui-même républicain modéré élu après l’assassinat de Sadi Carnot par un anarchiste), et de Félix Faure à partir de 1895.
Désormais, alors que la République est actée et que la question religieuse est mise entre parenthèses, la question sociale prend l’ascendant selon Jacques Julliard : les républicains hégémoniques se divisent entre les quatre familles historiques de la gauche (libéraux, jacobins, collectivistes et libertaires). Les libéraux, qui forment la colonne vertébrale du régime, sont les plus nombreux, soutenus par le Ralliement et gouvernant à travers le ministère Méline avec les républicains de droite. Selon Gilles Candar, la gauche est désormais composée par les radicaux (une centaine de députés environ entre 1889 et 1898), eux-mêmes divisés entre une « gauche progressiste » ou « gauche radicale » , et l’ancienne extrême gauche nommée « radicale-socialiste » à partir de 1895. Le parti radical, pour Jacques Julliard, se distingue alors par son anticléricalisme, et conserve sa volonté interventionniste dans l’économie (devenant au XXe siècle un parti plus libéral).
Léon Bourgeois, bref président du Conseil entre 1895 et 1896, développe ainsi le solidarisme, « quasi-contrat » entre l’individu et la société insérant l’homme dans un réseau de solidarités naturelles s’il en a la liberté, s’inspirant du traditionalisme et s’opposant à l’individualisme comme à l’économie libre-échangiste : l’État doit en effet s’assurer de l’égalité entre les citoyens, par l’impôt et l’assistance sociale notamment. Pour Gilles Candar, cette expérience permet cependant de « fixer des traits usuels de la gauche », notamment son projet de réforme des finances, de l’impôt sur le revenu, d’entente internationale pour les relations extérieures, de lutte contre l’affairisme, des réformes scolaires… Cependant, les progressistes restent dominants, malgré cette parenthèse de Léon Bourgeois due aux troubles sociaux qui usent les républicains de gouvernement, également affaiblis par les difficultés coloniales à Madagascar et des scandales financiers comme l’affaire des chemins de fer du Sud.
Après les élections de 1898 au cours desquelles les radicaux obtiennent 27% des voix et 180 députés, ils peuvent de nouveau former un gouvernement dirigé par Brisson ; cependant, les radicaux s’empêtrent dans l’Affaire Dreyfus qui s’ouvre à cette époque, et ne mettent par ailleurs pas de lois sociales en place. Le ministre de la Guerre, Godefroy Cavaignac, est persuadé que Dreyfus, officier juif, est coupable d’espionnage : alors même que le gouvernement saisit la Cour de Cassation pour réviser le procès de Dreyfus, le ministre puis ses successeurs veulent prouver sa culpabilité, sans que Brisson ose s’impliquer contre l’armée – il préfère ainsi s’attaquer aux dreyfusards, ce qui scandalise les radicaux-socialistes.
Discrédité, Brisson quitte le pouvoir, remplacé par le dreyfusien Waldeck-Rousseau en 1899. Le nouveau Président du Conseil, progressiste héritier du gambettisme, est soutenu par les radicaux et les élus socialistes, qui propagent leurs idées marxistes sous l’égide de Guesde mais qui acceptent de participer au gouvernement depuis l’exclusion des anarchistes de l’Internationale socialiste au congrès de Londres de 1896. Le socialisme, défini par Millerand et les guesdistes, se caractérise alors par l’intervention de l’État pour nationaliser les moyens de production et d’échange de façon progressive, la conquête du pouvoir par le suffrage universel, et l’entente internationale des travailleurs. Le socialisme, bien que devenu une force politique autonome dans les années 1890, participe au nouveau gouvernement par l’intermédiaire de Millerand. En effet, Waldeck-Rousseau amène avec lui la part la plus à gauche des progressistes, marquant le début d’une scission dans cette mouvance, entre les « Républicains progressistes » héritiers du mélinisme, d’autres progressistes qui fonderont la future Fédération républicaine au début du XXe siècle, et l’Alliance républicaine démocratique s’inscrivant dans l’esprit du gouvernement de Waldeck-Rousseau.
Les élus de 1898 sont pourtant, selon Julliard, nombreux à être hostiles ou indifférents à Dreyfus. Le gouvernement Méline avait été renversé par une majorité « exclusivement républicaine » s’opposant à la politique centriste d’apaisement, sans que cela n’ait signifié l’avènement du dreyfusisme. Ce n’est donc qu’à partir du 4 juin 1899, lorsque le nouveau président de la République Émile Loubet (considéré comme dreyfusard) reçoit un coup de canne sur son chapeau par un nationaliste antisémite, que la gauche bascule dans le camp dreyfusard par l’intermédiaire de Waldeck-Rousseau. Ainsi, aux yeux des radicaux et socialistes, l’Affaire concernait désormais la République : les antidreyfusards la remettaient en question, et il fallait donc prendre position, à une époque où Clemenceau et Jaurès, tous deux déjà dreyfusards, n’étaient pas aux responsabilités. Ils étaient alors publicistes : en effet, la gauche de cette époque s’incarne aussi à travers les « intellectuels engagés » , souhaitant utiliser leur notoriété pour mener une action politique en s’adressant aux citoyens vus comme des êtres pensants et opinants. Cette affaire, enfin, prend une dimension morale : soutenir Dreyfus devient soutenir la justice, qui devient équivalente à la République. L’Affaire, finalement, profite à la gauche, qui peut adopter cette posture morale et consolider la République.
Ainsi, avec le gouvernement Waldeck-Rousseau, une gauche de gouvernement, dreyfusarde et s’opposant principalement à la droite nationaliste parvient au pouvoir, alors que les gouvernements précédents, une fois la République institutionnalisée, se préoccupaient principalement de leurs adversaires à gauche : cette fois, bien que le gouvernement soit en majorité composé de progressistes, des réformes sociales (très modérées) seront mises en place, et cette nouvelle alliance de gauche (plus fondée sur le dreyfusisme et opposition aux nationalistes que sur une adhésion à la République sociale) sera bientôt à l’origine de la victoire éclatante du Bloc des gauches aux élections législatives de 1902, menant le radical Émile Combes à la présidence du Conseil.
Conclusion : la gauche du XIXe siècle
Concluons avec Alain Corbin, toujours dans l’ouvrage collectif cité. Selon l’historien, « l’homme de gauche » ne se désigne pas souvent comme tel au cours du XIXe siècle. L’expression pose problème, du fait de la recomposition permanente des frontières des systèmes d’alliances, des revendications et lignes de clivage entre gauche et droite : lorsque certaines revendications sont atteintes, notamment celles qui concernent le libéralisme politique et les institutions représentatives, des hommes de gauche modérés souhaitent ne pas aller plus loin dans les réformes, et passent alors dans le camp de la conservation, c’est-à-dire de la droite.
Ceci étant dit, Alain Corbin note que la gauche désigne les personnes qui acceptent l’héritage de la Révolution et des Lumières, même si cet héritage distingue 1789 (l’égalité civile, le gouvernement constitutionnel, le système représentatif…) et 1793 (le suffrage universel masculin, la Terreur, les réformes démocratiques et sociales…). Ce critère n’est que valable pour la première moitié du siècle, puisque certains hommes de droite revendiquent ensuite une partie de cet héritage. De manière générale, être de gauche au XIXe siècle signifie se tourner vers l’avenir et y voir le progrès, une conviction ancrée sur une vision historique de l’humanité. Ce progrès, lorsque l’on est de gauche, nécessite un engagement, une lutte contre la réaction résistant au progrès, afin d’établir un ordre nouveau fondé sur la raison plutôt que de revenir à un âge d’or mythique : c’est une attente d’une organisation sociale au bénéfice du plus grand nombre, répondant aux injustices, civilisant le corps social et le genre humain par l’instruction, voire la colonisation.
Dans les représentations collectives, les hommes de gauche semblent soumis « à la violence des passions » , désordonnés, parfois conspirateurs, capables de soulever le peuple (comme lors de la Terreur) et inspirant pour cela la peur. Ils sont aussi définis par leur sociabilité fondée sur le sentiment de fraternité, exprimée dans des cercles d’opinions, comme des clubs ou des théâtres, ou encore des banquets d’opposition, avec des gestes d’opposition comme la participation à des funérailles de personnalités républicaines. Participant à l’essor de la presse et esquivant la censure, ils sont aussi associés à des sentiments d’insatisfaction et de frustration face à des régimes qui les briment. Imbus de la conviction d’être investis d’une mission, ils propagent enfin une forme de propagande républicaine ou socialiste à destination de la population.
Au cours du siècle, les gauches traversent différentes étapes. L’opposition de gauche, sous la Restauration, se traduit d’abord par le libéralisme, qui revendique le maintien ou la confirmation des acquis de 1789 : un gouvernement constitutionnel et un pouvoir limité par un système représentatif, la liberté de la presse et des cultes, l’égalité civile, la défense des biens nationaux, et les jurys populaires. On trouve alors à gauche les « indépendants » (puis libéraux), les constitutionnels et doctrinaires, qui pourtant se trouveront à droite sous la monarchie de Juillet : en effet, devenus conservateurs une fois les acquis de 1789 consolidés par la révolution de Juillet, ils s’opposent désormais à la gauche dynastique, à la gauche radicale et aux républicains selon une nouvelle ligne de clivage : la question de la souveraineté populaire et l’étendue de son application. Être de gauche sous la monarchie de Juillet, c’est ainsi principalement se battre pour l’extension du droit de suffrage, voire pour le suffrage universel masculin, et pour certains la République.
Cependant, déjà à cette époque naît ce qui deviendra le socialisme, ainsi que les mouvements ouvriers, dont les revendications portent davantage sur l’organisation de la société ou sur l’autonomie des travailleurs dans le monde récemment industrialisé : leur priorité n’est plus politique, mais sociale, et la future ligne de clivage se dessine alors. En 1848, lorsque la IIe République est instaurée, les gauches se divisent une nouvelle fois : alors que tous se proclament républicains, la gauche de gouvernement (pourtant sincèrement républicaine) affronte violemment la gauche radicale sur la question sociale dès le mois de juin, révélant pour la première fois l’ampleur des dissensions à gauche entre les partisans d’une République libérale et ceux d’une République sociale.
Ces conflits facilitent le coup d’État de Bonaparte, et la fondation du Second Empire, qui éclipse les gauches contraintes à l’exil extérieur ou intérieur, mais permet d’unir une nouvelle fois libéraux et républicains dans un même objectif : rétablir les libertés en s’opposant à l’autoritarisme du régime. Après plusieurs étapes de libéralisation et la capture de l’empereur en 1870, la IIIe République instaurée, dominée par des conservateurs souhaitant restaurer la monarchie, se voit très vite menacée par une extrême gauche d’inspiration anarchiste : la Commune de Paris. Ce sont une nouvelle fois des républicains, menés par le converti Thiers, qui écrasent l’extrême gauche et la question sociale qu’elle pose. Pourtant, tandis que les orléanistes modérés acceptent la République par pragmatisme, les conservateurs voient leur influence diminuer au fil des élections, et les républicains modérés l’emportent à la fin des années 1870 : ils peuvent alors consolider le nouveau régime par des réformes essentielles correspondant aux principales revendications républicaines et libérales, sur la liberté de la presse, le droit de se syndiquer, l’éducation gratuite, laïque et obligatoire pour tous, le droit au divorce… Dans le même temps, le président de la République Jules Grévy, par sa pratique du pouvoir, accepte définitivement le parlementarisme et la prééminence de l’Assemblée, contrairement aux volontés conservatrices.
Alors que diverses crises et plusieurs scandales frappent la République, la ligne de fracture réapparaît sur la question sociale ; et, après les réformes de consolidation républicaine, plusieurs gouvernements ouverts à la droite (désormais républicaine) sont formés, dans une opposition à la gauche radicale et socialiste souhaitant des réformes sociales, notamment l’impôt sur le revenu et la limitation de la durée de la journée de travail. Ce n’est qu’à la toute fin du siècle, dans le cadre de l’affaire Dreyfus, qu’un gouvernement de Défense républicaine est formé par Waldeck-Rousseau en 1899, tournant la page de l’alliance avec les droites et renouant avec un véritable progressisme, social et dreyfusard : l’ère de la République radicale, de nouveau anticléricale et presque sociale, a sonné.
