Le champ de la recherche du politique nécessite encore ici d’être clarifié, considérant sa complexité et la confusion de certaines expressions, utilisées par différents acteurs à différentes époques pour renvoyer à des concepts en réalité très différents. Il en est ainsi pour la théorie politique.
Dans mes articles précédents, j’ai traité de science politique et de philosophie politique, en tâchant de présenter les nuances entre ces deux disciplines : alors que la science politique est, en quelques mots, une science sociale étudiant le domaine des règles régissant le vivre-ensemble afin de déterminer un fonctionnement consensuel de la société dans le contexte d’un affrontement entre intérêts contradictoires, la philosophie politique renvoie à l’établissement de connaissances sur ce que serait une bonne organisation politique et sociale de la société. La première discipline serait académique, la seconde morale ; la première chercherait à comprendre, la seconde à proposer.
Philippe Braud, on l’a vu, traitait de la théorie politique comme une sous-discipline de la science politique, se focalisant précisément sur l’étude de concepts comme le pouvoir, mais aussi sur la discussion des « grands modèles interprétatifs de la réalité sociale et politique » . Ce qu’il appelle modèle interprétatif renvoie à une représentation simplifiée permettant de comprendre le monde, le fonctionnement de la société, les relations entre les catégories sociales, et la façon dont elles coexistent et luttent ou collaborent pour structurer un espace commun. Par exemple, le marxisme est un modèle interprétatif de la réalité sociale et politique : les moyens de production seraient, selon cette théorie, contrôlées par des minorités dominant les autres, c’est-à-dire la bourgeoisie dans notre système actuel. Grâce à cette domination économique, la bourgeoisie aurait les moyens d’imposer sa domination politique, c’est-à-dire de gouverner et d’exercer le pouvoir. Elle utiliserait enfin ce pouvoir pour maintenir sa domination économique.
Le marxisme est donc une théorie politique. Mais il s’agit en même temps d’une philosophie, et c’est là que les choses se corsent : le marxisme est une idéologie critiquant le système capitaliste ainsi décrit, et prônant la propriété collective des moyens de production, c’est-à-dire le communisme, pour mener à la fin des classes sociales, en utilisant pour y parvenir les moyens de contrainte possédés par l’État. Cette idéologie repose sur le concept de justice sociale, et de répartition des richesses au bénéfice de tous, contre leur appropriation par des minorités.
Où se situe donc la théorie politique ? Peut-on vraiment la considérer comme une science explicative et positive du réel, ou est-elle plutôt une prescription normative recherchant une organisation bonne et juste de la société ?
Il n’existe pas de réponse définitive, étant donné que les chercheurs eux-mêmes ont varié et varient encore dans leur manière de considérer ce domaine. Heureusement, le politiste Sébastien Caré a écrit en 2021 un ouvrage synthétisant la théorie politique des années 1970 à nos jours : La Théorie politique contemporaine1. J’en utiliserai ici l’introduction pour définir notre objet.
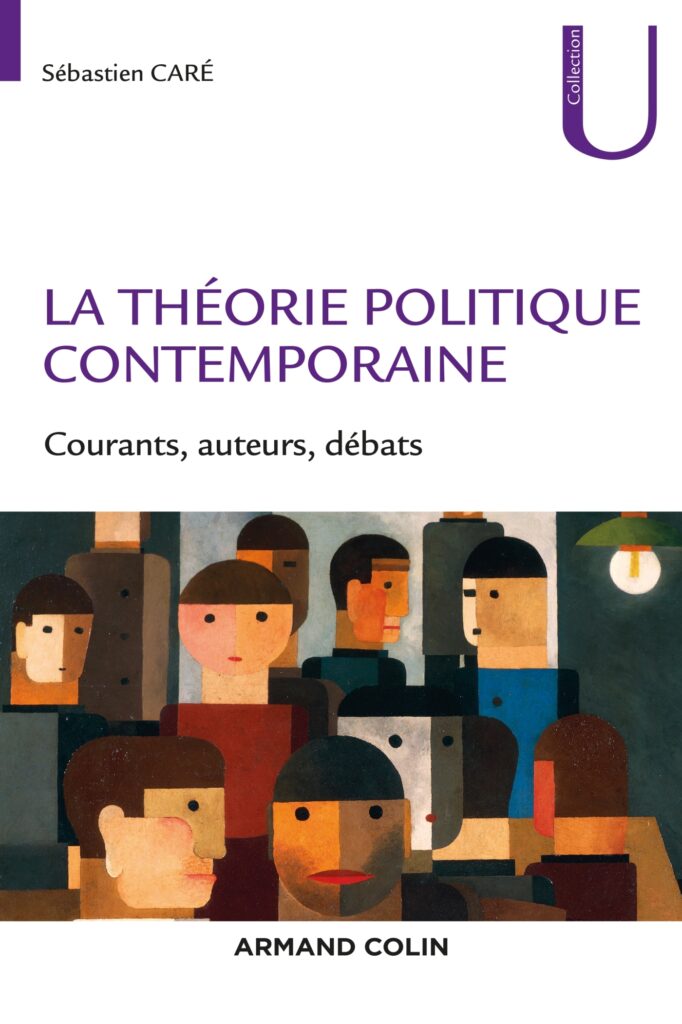
Sébastien Caré débute d’emblée en admettant la confusion caractéristique de l’expression « théorie politique » . Quelle est son ambition ? Quel est son périmètre ? Si les ambiguïtés tendent à être levés dans le monde anglo-saxon, pour l’auteur, en France, « l’état de confusion se trouve encore particulièrement marqué, sinon savamment entretenu. » . Le sociologue Raymond Aron, en 1961, décrivait comme impossible la réalisation d’une synthèse, ce qui n’est pas particulièrement encourageant. Sébastien Caré, cependant, s’est attelé à cette tâche.
Définition de la théorie politique
L’auteur revient séparément sur les deux termes considérés ici : « théorie » et « politique » .
La théorie, d’abord. Il la définit comme « une construction spéculative articulant un ensemble cohérent d’énoncés sur le réel » . En d’autres termes, il s’agit, comme pour un modèle, d’une simplification, permettant d’émettre un ensemble organisé d’idées et de règles, afin de comprendre le fonctionnement d’un domaine à grande échelle. C’est ce qui permet de sortir du cas particulier, empirique, pour aller vers une construction abstraite pouvant s’appliquer ailleurs, ce qui permet de simplifier le réel grâce à des règles générales : c’est ce qui caractérise une science.
Dans le domaine politique, nous pouvons rattacher deux sens différents au terme de théorie. D’abord, les théories explicatives, ou positives, c’est-à-dire fondées sur l’expérience et les liens de causalité entre les faits : elles ont pour but de proposer des modèles expliquant les liens de cause à effet, permettant de faciliter la prédiction de futurs événements. Ces théories sont semblables aux théories que l’on peut trouver dans les sciences dures, comme la théorie de l’évolution ; en sciences politiques, un exemple peut être la théorie wébérienne de la bureaucratie (selon laquelle le pouvoir appartient aujourd’hui de plus en plus à des experts choisis pour leurs compétences et non aux élus politiques). Il s’agit de la première définition de la théorie politique dont j’ai parlé plus tôt, comme science positive et explicative du réel ; mais, contrairement à Philippe Braud, il ne considère par que cette définition de la théorie politique renvoie à une sous-discipline de la science politique, mais plutôt à toute cette science, étant donné que la généralisation théorique est son objectif global. Nous pouvons considérer que Philippe Braud, dans une partie de sa définition de la théorie politique, (lorsqu’il insiste sur l’étude des concepts comme le pouvoir), rattache plutôt l’expression à l’idée de « thèmes » explorés par la théorie politique, à savoir les concepts et les notions, plutôt qu’à la démarche de généralisation elle-même.
La deuxième définition possible renvoie à un domaine proche, voir difficilement distinguible, de la philosophie politique : il s’agit des « théories politiques normatives, ou évaluatives, qui portent sur la réalité politique un jugement de valeur, et/ou confrontent à l’être observé un devoir-être systématisé » . Plus simplement, on pourrait rapprocher cette définition de celle de l’idéologie : il s’agit ici, comme l’explique le philosophe politique John Plamenatz en 1960, non pas d’expliquer le fonctionnement des gouvernements, mais de réfléchir à leurs objectifs. On retrouve ici clairement une définition semblable à celle de la philosophie politique.
Pour le terme « politique » , on retrouve les mêmes distinctions que j’ai déjà abordées dans un précédent article. « La » politique renvoie d’abord à « la scène où s’affrontent les individus et les groupements en compétition pour la conquête et l’exercice du pouvoir » , c’est-à-dire aux conflits, aux partis, à la vie électorale, ce qu’étudie la sociologie politique. « Les » politiques, renvoient aux politiques publiques, c’est-à-dire les différentes formes d’interventions de l’autorité publique, qu’étudie la sociologie de l’action publique. Enfin, « le » politique » consiste en « l’ensemble des principes, des règles et des institutions qui régissent le vivre-ensemble, et donc comme le lieu où se définit un intérêt commun transcendant les préférences particulières » . Il s’agit pour résumer de l’espace (immatériel) où l’on résout les conflits par des normes communes afin de vivre en société, de l’espace, aussi nommé champ politique, où interagissent les institutions. Pour l’auteur, cette définition est celle qui concerne l’objet de la théorie politique.
Ainsi, les théories politiques se focalisent sur les normes gouvernant la vie en commun : aux mécanismes, à la façon dont on obtient l’autorité, comment cette dernière devient légitime, à la façon dont les conflits se résolvent, aux rapports entre les membres de la société… En considérant ces objets, les théories politiques visent à répondre à des questionnements par des prescriptions, en se posant la question de la juste répartition des ressources, du rôle de l’État entre prescription de la « vie bonne » et maintien de l’ordre, de la participation des citoyens…
L’auteur donne donc la définition suivante à la théorie politique : « un ensemble cohérent d’énoncés normatifs portant sur les principes qui structurent la vie en commun et les fins qui orientent l’action publique » . Autrement dit, il s’agit d’un domaine de recherche académique visant à établir des normes abstraites dans le domaine de l’organisation du vivre-ensemble, du champ dans lequel les conflits d’intérêts se résolvent pour dépasser les clivages partisans, pour remplir des objectifs. Ces normes ont à la fois une visée explicative et prescriptive : l’auteur ne tranche pas le débat entre les deux sens de la théorie politique. L’ampleur du domaine légitime l’intervention de spécialistes ne provenant pas de la science politique, notamment des économistes et des historiens.
Pour distinguer la théorie politique de courants voisins comme la philosophie politique ou l’histoire des idées, l’auteur revient sur l’histoire de la discipline.
L’histoire récente de la théorie politique
Au XIXe siècle, on ne parle encore que de philosophie politique, et elle décline à cette époque du fait du développement des sciences sociales et du positivisme : leur but est en effet de démontrer des faits incontestables par l’expérience scientifique, et la spéculation abstraite, a fortiori normative (visant donc à établir des règles), est donc discréditée. Le phénomène s’accentue au XXe siècle : en 1940, le philosophe britannique Broad affirme qu’étant donné que les philosophes ne sont pas plus informés que n’importe qui pour distinguer le bien du mal, ils ne devraient pas prescrire quoi que ce soit. La possibilité d’une philosophie politique tournée vers la détermination de normes pour l’organisation commune serait dès lors inenvisageable. C’est à cette époque que l’on commence à parler de « théorie » politique plutôt que de philosophie, afin de la parer des atours de la science pour la rendre plus crédible.
Elle devient donc, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, une branche de la science politique, notamment aux États-Unis. Mais là aussi, le positivisme est en plein essor, et avec lui, le behavioralisme : une sous-discipline de la science politique utilisant la méthode scientifique et tournée vers l’étude des comportements politiques, en utilisant par exemple les statistiques pour quantifier les votes des parlementaires. Cela, sans jugement de valeur, contrairement à la théorie politique normative, qui se trouve donc de nouveau contestée. C’est à ce moment-là que certains chercheurs, comme Easton en 1951 et Dahl en 1958, proposent à la théorie politique de se rendre compatible avec le positivisme en abandonnant la spéculation normative.
La théorie politique normative trouve cependant des défenseurs à partir de cette époque, et durant les années 1960 : en premier lieu Léo Strauss (mentionné justement dans mon article sur la philosophie politique), qui refuse le terme de « théorie » et continue d’utiliser l’expression « philosophie politique » , montrant par-là une certaine résistance à la mode positiviste. Il réaffirme l’utilité de l’approche antique de ce domaine, c’est-à-dire de rechercher des connaissances politiques sans neutralité, permettant de déterminer de bons systèmes d’organisation sociale. D’autres chercheurs, comme Berlin, Germino et Wolin, défendent aussi l’idée d’une théorie politique engagée et normative.
Le renouveau appelé advient donc au début des années 1970, dans un contexte d’engagement croissant des étudiants contre la guerre du Vietnam : ils attendent du monde académique des réponses concernant l’égalité, la guerre, la justice… La théorie politique se renouvelle alors, d’abord avec Rawls et sa Théorie de la justice, qui s’attarde sur les principes de justice devant être garantis par les institutions. Plusieurs revues apparaissent, et le mouvement s’étend en Europe, notamment en France avec Julien Freund et Raymond Arond, culminant en la création en 1984 de l’Institut Raymond Aron à l’EHESS. La discipline connaît dès lors une nouvelle vitalité, plutôt dans son aspect normatif qu’explicatif – les « grands modèles explicatifs » pouvant en réalité être rattachés à l’ensemble de la science politique.
L’ambition de la théorie politique
L’auteur peut dès lors distinguer la théorie politique de l’histoire des idées, qui étudie les solutions politiques considérées dans le passé tout en les rattachant à un contexte historique afin de mieux comprendre le passé : la théorie politique a en effet pour but de penser la réalité présente, en proposant de nouvelles normes. Une séparation vis-à-vis de la philosophie politique est également possible : on utilise le terme de « théorie » lorsque la discipline est pratiquée par des politistes, ce qui rattache la théorie politique au champ des sciences, avec un intérêt pour l’applicabilité et à la réalité évaluée, ce qui n’est pas le cas dans la philosophie qui se suffit à elle-même. La distinction reste cependant, selon l’auteur, largement artificielle.
Il établit quatre postures théoriques distinctes. La première (minoritaire) est celle de Strauss et Wolin : assumer la « philosophie » politique en tant qu’histoire décontextualisée des idées. La deuxième (dominante), portée par Rawls et issue de la tradition de la philosophie analytique, veut conserver la réflexion normative sur le politique, en éliminant tout aspect métaphysique et en se fondant sur des énoncés validés par la logique. La troisième, plus modeste, ne cherche pas à définir un futur meilleur, mais à interpréter le présent (Shklar, Sen, Okaeshott). La quatrième, enfin, est la plus critique, issue de la philosophie continentale, et veut mener à une « transformation émancipatrice » : elle est représentée par la philosophie sociale de l’École de Francfort (Habermas, Honneth, Rosa) et par la pensée critique de Butler, Foucault et Negri.
Cet historique permet de donner trois fonctions différentes à la théorie politique : une fonction prescriptive (pour définir les normes de l’organisation sociale légitime), une fonction critique (afin de soutenir les luttes pour l’émancipation en affirmant que les rapports de domination existants sont contingents, c’est-à-dire non éternels), et une fonction heuristique (pour interpréter les phénomènes et rendre intelligible le monde politique, de façon neutre, par exemple avec les chercheurs Mark Bevir et Rod Rhodes qui interprètent les faits en utilisant les théories normatives déjà constituées).
Justifier les théories politiques : la morale
La place spéciale de la théorie politique dans le champ des sciences tient à son caractère normatif : l’un de ses buts est de proposer des bonnes et justes règles d’organisation sociale pour la vie en commun, ce qui implique dès le départ d’avoir une certaine vision de ce qui est bon et de ce qui est juste. De ce fait, la philosophie morale devient un fondement de cette science, et il est nécessaire de l’aborder.
Trois types d’approches existent pour la philosophie morale. La première est constituée par les doctrines déontologiques : selon ces dernières, on doit juger chaque action et règle par rapport à son respect de certains devoirs moraux, indépendamment des conséquences – c’est la philosophie morale de Kant, qui priorise le juste sur le bien. Pour déterminer les devoirs en question, on peut partir du principe qu’il existe des droits naturels devant être respectés dans tous les cas (selon les libertariens Rothbard et Nozick), ou défendre plutôt une justice procédurale (théories contractualistes de Rawls et Habermas), les règles étant considérées justes si elles sont élaborées en suivant une procédure valable.
La deuxième approche est conséquentialiste : le jugement des actions et règles ne se fait pas selon le respect de ce qui est juste, mais selon les conséquences apportées. Le bien est ici priorisé au juste : une action serait juste si elle a pour conséquence la maximisation du bien. On retrouve cette philosophie dans l’utilitarisme de Bentham, qui considère que la morale implique de maximiser le plaisir et de minimiser la peine, à l’échelle collectif : le politique aurait pour rôle de garantir « le plus grand bonheur du plus grand nombre » . Cet utilitarisme peut privilégier la diminution des souffrances (Smart), ou la satisfaction des désirs (Singer) ; il peut être pensé à l’échelle d’une action, ou d’une règle (Brandt).
La troisième et dernière approche est celle de l’éthique de la vertu, rattachée à Aristote puis saint Thomas, avant d’être reprise en 1958 par la philosophe britannique Elizabeth Anscombe pour dépasser l’alternative précédente. La vertu, dans cette approche, remplace le concept de devoirs : la priorité du politique devrait être dans ce cadre l’accomplissement des vertus de chacun. Les actions et les règles ne sont pas au centre de cette pensée, mais les personnes elles-mêmes, et la façon dont elles mènent leur vie, indépendamment du rapport aux autres. L’excellence est recherchée, en prenant l’exemple de personnes vertueuses pour agir comme elles. Avec cette approche, les concepts concrets de l’honnêteté et de la générosité sont par exemple préférés à ceux de justice et de bien, trop généraux. Cette approche est dite perfectionniste.
Conclusion
Nous pouvons conclure de ce travail que la théorie politique, bien que diversifiée dans son objet, ses ambitions et ses méthodes, tend dans la pratique à se rapprocher de la philosophie politique, en renouant avec ses origines normatives. Malgré quelques courants minoritaires tournés vers l’interprétation positive et démontrable des faits politiques, la théorie politique se focalise en majorité sur la recherche de la bonne et de la juste organisation de la vie en communauté, et des règles à établir pour réguler les conflits entre les personnes et les groupes, tout en respectant la méthode scientifique.
Il s’agit donc de la principale différence avec la philosophie politique, qui ne fait pas appel à cette méthode inspirée par le positivisme. Cependant, dans l’esprit, les deux disciplines poursuivent les mêmes buts, en renonçant à la neutralité axiologique qui est d’ordinaire la règle en science politique, et plus largement, dans tout le champ scientifique. L’appel à la philosophie morale, dans ce contexte, contribuer à donner une place bien à part à la théorie politique au sein des autres sciences sociales, qui ne reposent pas sur une certaine vision du bien et de la justice.
Malgré la vocation scientifique de la théorie politique, l’immense diversité de ces théories contemporaines, depuis les années 1970, ne ferait pas honte à la philosophie politique antique, médiévale et moderne. On peut considérer alors que la dimension scientifique et objective de la théorie politique n’est pas donc pas encore pleinement accomplie. Pourra-t-elle l’être un jour ?
- CARÉ Sébastien, La Théorie politique contemporaine. Courants, auteurs, débats, Paris, Armand Colin, 2021, 301 p. ↩︎
