Après avoir étudié l’histoire des droites, il est temps de nous pencher sur celle des gauches et d’abord sur leurs origines. Avant d’aller plus loin, je pense qu’il est pertinent de faire un point sur l’identité théorique des gauches, et ce qui les sépare des droites – j’écrirai cependant plus tard un article focalisé complètement sur ce sujet.
Nous avons pu aborder, par pans successifs, les philosophies et sensibilités des gauches et des droites, placer d’un côté le socialisme, et de l’autre l’autoritarisme et le libéralisme. Autrement dit, la volonté de répondre à la question sociale par la collectivisation des moyens de production et l’équitable répartition des richesses, contre deux droites : la droite libérale puis néolibérale favorable au progressisme des mœurs et attachée à l’initiative personnelle et au libre-échange au détriment de la souveraineté nationale, et la droite nationaliste hostile à la mondialisation et à l’ouverture des frontières entraînant la libre circulation des capitaux et des hommes.
L’histoire des droites nous a donc appris, tout comme le paysage actuel découpé entre gauches relativement unies (LFI, PS, Ecologistes et PCF), « centre » et droite néolibérale (MoDem, Renaissance, Horizons, LR), et droite nationaliste (UDR, RN et Reconquête), que le champ politique donnait plutôt naissance à une tripartition qu’à un véritable bipartisme, en tout cas en 2025 – ce qui est le résultat d’un affaiblissement historique des gauches les contraignant à une certaine unité, tandis que les droites hégémoniques font basculer la ligne de fracture principale de la société en leur propre sein, entre mondialistes et nationalistes. L’opposition entre gauche réformiste et gauche collectiviste, bien qu’existant encore aujourd’hui, est bien moins prégnante du fait du déséquilibre actuel au profit des droites.
Est-il, pour autant, impossible de parler d’un réel clivage gauche-droite, et de là, d’affirmer l’existence de gauches et de droites ? Je ne le crois pas. Ce clivage, historiquement, s’est construit sur l’opposition bien connue entre les députés opposés au droit de veto du roi Louis XVI lors de la Révolution française, regroupés à gauche de l’hémicycle, alors que les députés favorables s’installaient à droite. La gauche désignait alors l’alliance politique favorable à la souveraineté populaire, alors que la droite y était opposée.
De manière générale, c’est ensuite ainsi que le clivage s’est poursuivi : les gauches représentaient ceux qui étaient favorables aux principes de la Révolution, aux droits de l’Homme, et à la souveraineté populaire, alors que les droites y étaient opposées. Les droites, dès cette époque, se sont construites par opposition aux gauches, en réaction à elles.
On dit souvent que la valeur cardinale de la droite est la liberté, alors que celle de la gauche est l’égalité ; je suis en désaccord. Cette analyse n’est valable qu’en économie, avec l’opposition entre une droite partisane du libre-échange, de l’initiative personnelle et de la propriété privée, et une droite favorable à la régulation et à la collectivisation des moyens de production pour répartir les richesses. Elle ne prend pas en compte l’évident attrait de la droite pour la conservation des traditions et le maintien de l’ordre, des éléments a priori incompréhensibles si on veut forcer l’association entre droite et liberté. Historiquement, en effet, la droite est le camp de l’absolutisme, de la souveraineté royale : le libéralisme, sous la Révolution et dans la première moitié du XIXe siècle, était une valeur résolument de gauche, même s’il ne l’est plus dans sa forme actuelle.
Pour moi (mais je préciserai ce point de vue et l’agrémenterai d’autres références dans un article ultérieur), le véritable clivage se situe dans le rapport à l’égalité, la valeur de la gauche – ce qui est logique, puisque le clivage a en effet été construit par la gauche, qui est bien celle qui s’est révoltée au moment de la Révolution. De façon très simple, la gauche est le camp de ceux qui croient en l’égalité entre les êtres humains, en la défense de leurs droits, si nécessaire par la contrainte pour réduire voire supprimer les inégalités, qu’il s’agisse d’inégalités civiles ou matérielles, des inégalités de richesse ou entre nations, par idéal humaniste. La droite, en revanche, est le camp de ceux qui acceptent les inégalités, les hiérarchies, les traitements différents selon les nationalités, la concentration des richesses au profit de minorités, par pragmatisme réaliste et conviction que ces inégalités sont la condition de la survie et de la prospérité de notre société.
Encore plus simplement, être de gauche, c’est être révolté face aux injustices du monde et aux souffrances de ses semblables ; être de droite, c’est être effrayé par la possibilité que la société s’effondre. Être de gauche, c’est être en colère ; être de droite, c’est avoir peur.
Sur ces bases, nous pouvons entamer l’histoire des gauches, en partant pour cela de l’ouvrage de Jacques Julliard : Les Gauches françaises1.
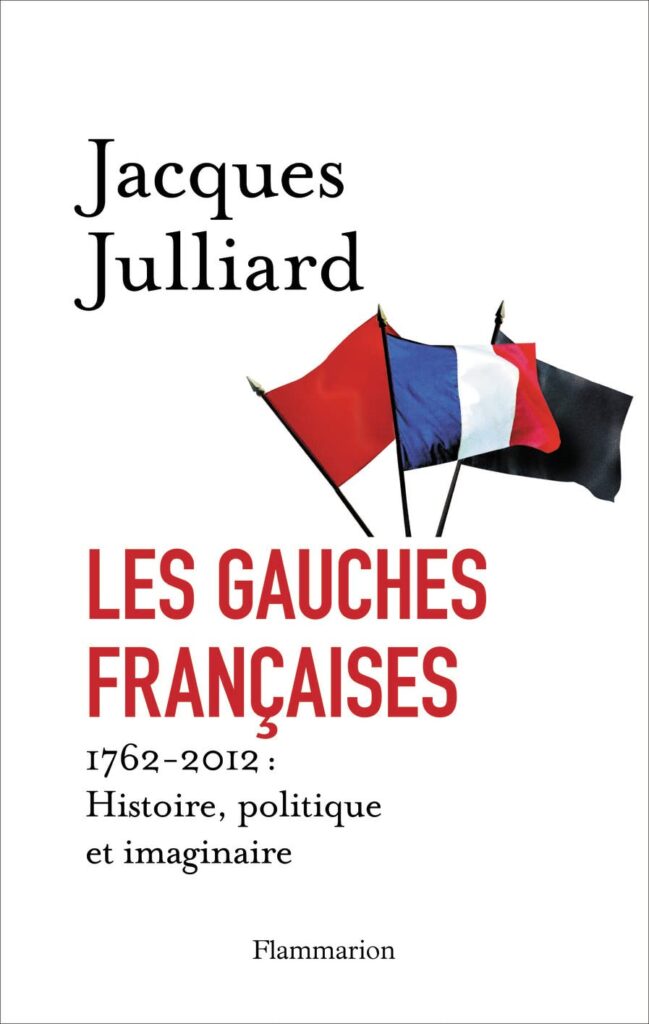
L’avenir rêvé : la naissance des gauches dans la philosophie du XVIIIe siècle
De façon appropriée, l’histoire des gauches débute par une révolte contre l’ordre établi ; et cette révolte tire ses origines intellectuelles de la philosophie des Lumières. Ce siècle est celui de l’amour de la nature, associée à l’idée de science et de déterminisme, contre la religion dogmatique. La nature est alors polysémique, on peut la trouver dans les sciences humaines ou physiques : c’est l’esprit du siècle, notamment représenté par Rousseau (1712-1778), qui pense que l’homme est imparfait précisément parce qu’il n’est pas entièrement naturel, et que le progrès scientifique et technique mène à la déchéance morale, comme expliqué dans ses Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de 1755. L’un des seuls pessimistes de son siècle, il pense que cette évolution est irrémédiable, et qu’il faut en tenir compte. Voltaire (1694-1778) est plus ambivalent, refusant la décadence mais critiquant en 1759 dans Candide l’optimisme systématique de Leibniz.
Turgot (1727-1781), enfin, développe sa philosophie de l’histoire en 1750 en affirmant, avant Condorcet, « les progrès successifs de l’esprit humain » , associant l’idée de progrès à un aspect spirituel plutôt que seulement matériel. Turgot, prieur, considère que les grands esprits, l’éducation, la soif d’innovation et l’influence du christianisme entraînent le progrès ; Condorcet s’opposera à ce dernier point, en tant qu’anticlérical. Dans son Ébauche du second discours sur l’histoire universelle, il précède Comte en distinguant trois périodes dans l’histoire de l’humanité : celle où les phénomènes naturels sont associés avec ce que les êtres humains trouvent en eux-mêmes, celle où des expressions abstraites sont vues comme des divinités, et celle où on étudie l’action mécanique réciproque des corps, comme l’âge positif. Ainsi, peu à peu, les dieux sont éliminés de l’explication des phénomènes naturels.
Condorcet (1743-1794) est la pièce finale de cet édifice intellectuel, répondant par son optimisme à Rousseau dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain paru en 1795 de façon posthume, après avoir été rédigé pendant sa fuite alors qu’il est accusé d’être un Girondin. Il affirme dans ce texte que le progrès des connaissances mène en réalité à l’adoucissement des mœurs : cette position de l’optimisme progressiste sera celle du XIXe siècle, alors que Rousseau regagnera en popularité à la fin du XXe siècle et au début du nôtre, avec l’essor de l’écologisme. C’est sous l’influence de Turgot et Condorcet, puis de la Révolution, que le progrès comme idée maîtresse prend son essor, et s’incarne à travers la gauche : l’idée selon laquelle l’histoire mène continument l’humanité vers l’unité et la fin des inégalités, alors que l’homme se perfectionne physiquement, intellectuellement et moralement.
Le progrès des techniques mène ainsi à l’amélioration de la condition matérielle des hommes, qui entraîne le progrès moral de l’humanité, un processus semblable à celui du matérialisme historique, dont les origines se trouvent elles-mêmes dans les facultés mentales. Cette conviction est déterministe, avec des conséquences qui se succéderaient, jusqu’à l’unification de l’humanité libérée de toutes les inégalités, et du mal grâce à l’éradication de l’ignorance. C’est pourquoi Condorcet prête autant d’attention à la question de l’instruction., pour offrir à chacun, pour tout le genre humain la possibilité de subvenir à ses propres besoins, de faire respecter ses droits et d’accomplir ses devoirs, avec comme visée le bien-être matériel, l’émancipation politique et l’instruction civique. La science serait ainsi au service de la justice, un idéal partagé tout au long du siècle suivant, en particulier par les républicains dont il est le principal inspirateur – les révolutionnaires prônant l’égalité sans s’attacher autant à la science, et de façon tyrannique. Condorcet, lui, pense que la vérité doit être indépendante de l’autorité publique, et veut donc une instruction libre, même si la IIIe République la rendra obligatoire. Condorcet défendait aussi l’éducation permanente, au-delà de l’enfance, et l’égalité entre les hommes et les femmes, un point de vue révolutionnaire à l’époque. Ce projet intellectuel est celui de toute la gauche croyant au développement de l’esprit humain, là où une autre gauche préférera placer la liberté à son service en monopolisant l’éducation.
Les gauches, inexistantes à cette époque, revendiqueront rétrospectivement l’héritage des Lumières, même si ces philosophes divergent largement, les Encyclopédistes soutenant par exemple le système autocratique, Voltaire soutenant lui aussi le despotisme éclairé, alors que Montesquieu, pourtant libéral, est moins cité. Ces intellectuels, déjà, ont tendance à courtiser des pays autoritaires à l’étranger où ils cherchent à exercer leur influence, quitte à soutenir des invasions à rebours de leurs convictions supposées, réduits à se placer dans l’ombre de « Princes » ou de « Mécènes » pour agir, dans cette époque précédant la démocratie. Le XVIIIe siècle, en réalité, était assez matérialiste, le pouvoir des idées sur le réel n’était pas particulièrement craint, et les critiques de l’ordre établi étaient souvent émises par des gens qui, dans la pratique, en profitaient et ne faisaient rien pour le changer. Les seuls philosophes de leur temps à s’engager sont ainsi Voltaire, notamment pour l’affaire Calas, et Condorcet, tandis que les autres (Rousseau, Diderot, Montesquieu) vivent la belle vie auprès des puissants. Les Lumières, en réalité, sont condescendantes, non socialistes, et pas républicaines non plus. La vision d’un XVIIIe siècle de gauche est construite rétrospectivement, pour se créer une filiation a posteriori. Les valeurs de liberté de pensée, d’esprit critique, de tolérance, de rationalité, de progrès pour le bonheur, sont revendiquées par une philosophie républicaine (entre 1871 et 1914), mais pas par toute la gauche : Ferry et Jaurès y sont favorables, mais pas Thorez et Sartre, l’extrême gauche communiste considérant que les droits de l’homme viennent de la bourgeoisie, et s’opposant nettement à la tolérance, et même à la raison. C’est ce qu’on peut voir en mai 1968 chez les « gauchistes » tels que décrits par Jacques Julliard, qui rappelle leurs provocations et leur opposition au rationalisme. On voit là une scission avec la gauche du parti radical et des socialistes, qui revendique l’esprit des Lumières, comme le fait la droite libérale.
Le groupe social des intellectuels, part essentielle au sein de la sociologie des gauches en tant que producteurs intellectuels exerçant une influence sur la société et le champ politique, est également né au XVIIIe siècle. Selon Tocqueville (1805-1859), ces « gens de lettres », formant ce qu’on nommerait aujourd’hui une intelligentsia, exercent indirectement leur influence en développant des théories abstraites faisant table rase du passé, par exemple sur les droits de l’homme. Comme le peuple, ils n’exercent pas le pouvoir, ce qui les rapproche et pousse certains Français ulcérés à approuver leurs grands principes en réaction aux injustices dont ils sont victimes. Ainsi, les dirigeants font face à des groupes sociaux écartés du pouvoir mais imaginant de nouvelles solutions : c’est ce que Jacques Julliard appelle l’esprit français, critiqué notamment par Edmund Burke dans ses Réflexions sur la Révolution de France (1790) pour sa recherche d’une égalité « formelle et trompeuse », d’une table rase et d’une organisation sociale radicalement nouvelle. Les intellectuels resteront jusqu’à aujourd’hui à leur place, entre société civile et politique, influençant les contestataires par frustration de ne pas exercer le pouvoir, intégrés par la gauche politique pour éviter leur dissidence.
Hippolyte Taine (1828-1893) étudie lui-même les intellectuels français, et associe l’esprit classique de Descartes, et l’individu abstrait qu’il a conceptualisé, avec Rousseau puis les révolutionnaires comme Robespierre, qui reprennent ce même individu abstrait dans l’idée de contrat social. D’autres philosophes, comme Habermas et Gramsci, étudient également ce groupe social et ses visées hégémoniques sur l’espace public au sein de salons, cafés, et autres lieux privés liés à l’espace littéraire tel que décrit par Habermas. Ces intellectuels peuvent alors se faire le clergé de la Révolution auprès des classes populaires et bourgeoises, en concurrence avec le clergé catholique. L’écrivain est dès lors, selon Paul Bénichou (1908-2001), un pouvoir spirituel laïque, en tant que porte-parole, tourné vers le peuple.
L’opinion publique, au XVIIIe siècle, existe déjà selon Tocqueville : elle est produite par les intellectuels, exclus de l’exercice du pouvoir et exprimant donc leur mécontentement, qui devient celui de la société civile, laquelle bascule dans l’opposition au gouvernement. L’opinion publique, à cette époque, est l’échange des opinions de façon visible, avec des points de vue diversifiés, et une reconnaissance de la légitimité du débat : c’est ce qui donne naissance à la politique, une politique « littéraire » selon Tocqueville, mais aussi « philosophique » . Cette opinion publique n’est pas la même qu’aujourd’hui, car elle ne désigne pas la totalité de la population, mais l’élite pensante de la société cultivée, jugeant et arbitrant les pouvoirs par le biais de l’impression, marquant le début de la fin de l’absolutisme. Le peuple reste cependant récepteur de l’opinion, qui n’est pas démocratique, même si l’opinion, pour être acceptée, doit se rendre acceptable aux yeux des « opinés » , qui ont tout de même la possibilité de libre examen – c’est une étape préalable au suffrage, Condorcet lui-même considérant que la démocratie ne peut advenir que par l’instruction du peuple par la science, et donc, les intellectuels.
Le XVIIIe siècle est aussi à l’origine de la vision de la politique « comme action publique volontaire » visant un projet précis. Jusque-là, malgré quelques principes de gouvernement, des experts choisis par le roi dirigent les affaires courantes. Mais à partir du XVIIIe siècle, les choix du roi sont discutés, car on considère que c’est à l’État de réformer la société, du fait de l’absolutisme – qui est donc l’origine de l’étatisme de gauche. La politique devient dès lors, en France, « les efforts entrepris pour déclencher la puissance réformatrice de l’État » : historiquement, c’est un concept de gauche, fondé sur l’idée rousseauiste de perfectibilité de l’homme (contre l’idée de perfection du pouvoir de droit divin, et l’immuabilité de la Nature).
Les partis ne sont quant à eux pas issus du XVIIIe siècle, l’opposition entre monarchie absolue et monarchie limitée existant déjà des siècles plus tôt, par exemple entre Armagnacs et Bourguignons au XVe siècle ou entre frondeurs et Mazarin au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle, l’opinion et le débat font de ces partis des mouvances intellectuelles représentées au pouvoir et défendant des projets complets. Ces projets sont parfois des utopies, irréalisables sur le plan politique, mais témoignant de l’évolution des mentalités : leur réalité est insatisfaisante, et l’égalité devient le but recherché. La plupart des utopies ont en effet des projets égalitaires, à commencer par Rousseau dans son discours sur l’inégalité qui valorise le passé révolu et qui critique les inégalités, même s’il pense qu’elles sont inévitables du fait de la perfectibilité de l’homme. Les utopistes, et la gauche en général, sont quant à eux plus optimistes, et croient que le mauvais peut être éliminé. Morelly écrit ainsi le Code de la nature en 1755, y défendant la fin de la propriété (et de la monnaie), origine selon lui du mal – mais, dans sa société idéale, il définit déjà une forme de totalitarisme, où les enfants sont retirés à leurs parents à cinq ans pour être confiés à l’État et supprimer les inégalités. Ces utopies, liant suppression de la propriété et de la monnaie, réorganisation égalitaire de la société, et rôle prépondérant de l’État, sont à l’origine de la pensée de gauche en France, comme en URSS. La passion de l’égalité est ainsi issue du XVIIIe siècle – la liberté venant en 1789, et la fraternité en 1848, l’égalité étant la seule à n’être admise que par la gauche.
La mutation révolutionnaire la plus profonde se produit en lien avec la dimension religieuse, le progressisme étant en France particulièrement opposé aux croyances religieuses, contrairement aux États-Unis par exemple où la religion est un fondement de la liberté. La France développe quant à elle « une laïcité d’abstention et d’ignorance du fait religieux » , au cours de la IIIe République et à la suite des Lumières, les Encyclopédistes détestant l’Église alors que les révolutionnaires préfèrent s’opposer à la monarchie absolutiste et s’inspirent en réalité du jansénisme.
Le jansénisme de l’abbaye de Port-Royal, associé à un zèle religieux sectaire et intransigeant, de l’austérité, la controverse intellectuelle, le pessimisme, le tempérament contestataire et un sentiment aristocratique de supériorité morale associé à un désintéressement ostentatoire, est un courant de pensée théorisant la prédestination, c’est-à-dire la vision d’un Dieu décidant par avance quelles que soient les actions humaines. Ils sont au cœur des discussions entre le traité De la fréquente communion d’Arnauld publié en 1643 à la proscription de la Compagnie de Jésus en 1643. Reclus sur eux-mêmes dans leurs réseaux et écrivant de façon clandestine, ils veulent se comparer aux premiers chrétiens, et prônent le figurisme, comparant leur époque à l’Histoire sainte.
Lorsque le pape Clément XI publie la bulle Unigenitus en 1713 pour condamner le jansénisme, ce dernier se regroupe pendant dix ans sous l’égide de Saint-Magloire, influençant l’opinion publique par l’hebdomadaire Nouvelles ecclésiastiques de 1728 à 1803, financé notamment par la « boîte à Perrette » collectant les legs faits aux jansénistes et nourrissant leur machine propagandiste au XVIIIe siècle. D’abord théologique, le jansénisme bascule dans le débat parlementaire. Ainsi, lorsque le curé de Saint-Étienne-du-Mont refuse les derniers sacrements à un prêtre pour jansénisme en 1752, le Parlement interdit cette pratique, ce qui provoque un conflit politique avec le roi en 1753, les parlementaires étant exilés hors de Paris. Le roi cède finalement en 1755 en n’appliquant pas la bulle Unigenitus. Les jésuites étant expulsés en 1764, les jansénistes ne sont alors plus les révoltés qu’ils étaient. Mais, comme les révolutionnaires et la gauche après eux, ils avaient exercé leur influence minoritaire sur les masses, mettant des instruments de propagande au service de leur idéologie et de leur « anticléricalisme » associant Église et pouvoir royal. L’abbé Grégoire, ecclésiastique mais révolutionnaire, sera la dernière figure de cet esprit janséniste, entrant dans l’imaginaire de gauche.
Ainsi, le jansénisme, proche jusqu’à la fin du XVIIIe siècle du richerisme d’Edmond Richer (1559-1631) affirmant que l’infaillibilité appartient à l’Église universelle plutôt qu’au pape et donc à une démocratie cléricale (ou basisme), et qui s’approche aussi du gallicanisme faisant du roi le protecteur de l’Église du France et des conciles généraux une autorité supérieure au pape, contribue à « régénérer le christianisme par le biais de la Révolution et […] spiritualiser la Révolution par le biais du christianisme » : ainsi naît la Constitution civile du clergé, janséno-richeriste d’inspiration même si les jansénistes de l’époque la rejettent. Cette religion d’État n’est cependant pas acceptée par l’ensemble du clergé, comme le gallicanisme avait lui-même été rejeté par certains : il ne s’agissait pas, en réalité, d’une attaque contre la religion, mais d’une volonté de refonder les liens entre religion et société civile en plaçant le gouvernement politique au premier plan.
La Révolution était ici l’héritière de l’Ancien Régime, davantage que des Lumières : les révolutionnaires, comme les partisans de la monarchie absolue avant eux, croient en la toute-puissance du politique. Cette conviction n’est cependant pas janséniste : l’autorité est perçue comme un instrument rationalisé de la volonté humaine, ce qui est une pensée thomiste (inspirée de Saint Thomas d’Aquin) au XIIIe siècle, selon lequel la raison et la volonté structurent le monde politique, ce qui signifie que l’État est un instrument légitime pour organiser la société selon un ordre rationnel et juste. En revanche, Saint Augustin, né au IVe siècle, considérait que le politique était secondaire par rapport à la transcendance divine, comme les jansénistes. La France s’approche plutôt du modèle « césaro-papiste byzantin » , c’est-à-dire un système où le pouvoir politique domine le pouvoir religieux pour transformer totalement la société, d’où une attente très forte encore aujourd’hui, et d’où l’échec des jansénistes, augustiniens croyant en la prédestination, dont la conviction était contraire.
La Constitution civile, d’inspiration gallicane pour son projet de réorganisation de l’Église, et influencée par les légistes qui diminuent le nombre d’évêchés pour faire du clergé un fonctionnariat soumis aux autorités civiles, est donc richeriste (par l’élection initialement prévue des membres du clergé par le peuple), est en contradiction avec une partie du jansénisme, qui n’est pas étatiste tout en restant indépendant vis-à-vis de Rome, et qui reste élitiste, favorable à la démocratie uniquement dans les paroisses. Le jansénisme disparaît progressivement à partir de cette époque, incapable d’aller plus loin que la remise en cause de l’absolutisme.
Augustinien, le jansénisme défendait l’idée de péché originel et de grâce, c’est-à-dire l’idée que Dieu décide quels hommes, touchés par la grâce, pourront accéder au Paradis, alors que les jésuites sont adeptes du molinisme, combattant cette idée élitiste : selon l’historien Kolakowski, l’augustinisme n’était plus adaptée à l’Église universelle du XVIIIe siècle, qui considère que le Christ est mort pour tous les hommes, dans un « universalisme du salut » , tandis que les jansénistes croient au salut d’une minorité. Les jésuites « progressistes », pélagiens d’inspiration (du nom du moine Pélage opposé à la doctrine augustinienne de la grâce au IVe siècle et déclaré hérétique) participent ainsi à la naissance de l’universalisme clérical puis révolutionnaire. Dès la Réforme, les protestants, plus orthodoxes, sont augustiniens, contre l’humanisme pélagien de la Renaissance. Et au XVIIIe siècle, les Lumières contredisent la notion augustinienne de péché originel, préférant l’optimiste universaliste et humaniste au pessimisme janséniste ou calvinisme. Pascal, qui oppose la misère de l’homme sans Dieu à sa grandeur lorsqu’il est avec Dieu, croit en la chute de l’homme, mais souffre lui-même des contradictions en prédestination et salut universel.
Le jansénisme s’oppose certes à l’absolutisme, mais dans une philosophie rigoriste et pessimiste que l’on ne pourrait qualifier de gauche dans ses fondements, alors que les jésuites, soutenant le libre arbitre et la liberté humaniste, inspirent la gauche universaliste des droits de l’homme. Les jansénistes sont cependant populaires auprès des « bourgeois » du XVIIIe siècle : les marchands, négociants, avocats… classes sociales qu’on retrouve dans la lutte contre l’absolutisme, et qui sont pourtant nostalgiques du passé avec une vision tragique de la condition humaine. Le jansénisme, réactionnaire plutôt que progressiste, opposé à l’absolutisme par un concours de circonstances, disparaît donc après la fin de la monarchie absolue, loin d’être l’ancêtre du progressisme de gauche considéré comme tel par des socialistes comme Louis Blanc.
Selon l’historien moderniste Le Roy Ladurie, Calvin (à l’origine du courant calviniste) serait à l’origine intellectuelle de la gauche et de son anticléricalisme, dès le XVIe siècle, ce que pensait aussi Balzac qui pense que le protestantisme est à l’origine de l’individualisme et de la liberté de conscience. L’opposition serait protestante, car fondée sur la discussion, la négation de la politique gouvernementale par l’esprit critique, les traditionalistes considérant que le suffrage universel conduit donc à la paralysie plutôt qu’à l’action. La persécution des protestants par Catherine de Médicis aurait donc eu comme justification la raison d’État : cette volonté d’unité serait ensuite incarnée par Robespierre, et d’autres, légitimistes comme de Maistre ou républicains comme Edgar Quinet, contre la pensée libérale favorable à l’opposition de l’esprit humain au pouvoir absolu. L’orléaniste Guizot regrette ainsi que la Révolution n’ait pas mené au même résultat qu’en Angleterre, que l’esprit protestant de 1789 ait mené à l’unitarisme jacobin d’essence catholique de 1793.
Les montagnards ne sont en effet pas des individualistes : ils défendent l’universalisme abstrait et cartésien, mais ne souhaitent pas d’un moralisme abstrait et protestant, qui met en danger l’unité nationale par la libre critique individuelle et l’opposition. Même à gauche, on trouve donc des fractures entre ceux acceptant 1789 et non 1793, 1793 et non 1789, ou les deux. Pour autant, Calvin au pouvoir n’est pas aussi tolérant qu’on le croit : la rigueur calviniste ne peut non plus être considérée comme l’origine du libéralisme de 1789 favorable aux droits de l’homme.
En d’autres termes, être opposé à un régime absolutiste ne signifie pas être progressiste ; et l’origine des Lumières se trouve davantage dans l’humanisme du XVIe siècle, incarné par Érasme, ses successeurs étant favorables comme les molinistes à l’idée d’une grâce offerte à tous (même si tous ne l’accueillent pas), que chez les calvinistes. Les filiations historiques et intellectuelles, termine Jacques Julliard, se contredisent.
En réalité, on peut opposer deux gauches à l’issue de ce siècle : une gauche jésuite et une gauche janséniste (métaphoriquement, ou d’inspiration : il ne s’agit pas réellement de jésuites ou de jansénistes). Pourtant, la gauche dans son ensemble se caractérise par le rejet de l’Église catholique et le cléricalisme, davantage que par la question sociale, ce qui est une originalité française liée aux philosophes du XVIIIe siècle et à la mutation religieuse et intellectuelle transformant les Français dévots en rationalistes opposés à l’origine miraculeuse de la Révélation. L’Église est assimilée à l’absolutisme et à tout l’ordre social, et les jésuites à tout le clergé, concentrant les colères. A partir de 1914 et de la réconciliation entre Église et République, la gauche perd son unité, et se disloque. Ses deux courants apparaissent alors plus clairement, entre gauche jésuite et gauche janséniste.
Ainsi, la gauche janséniste, dont les membres sont en général déjà nés dans un milieu de gauche, se pense élue, une avant-garde devant mener les masses et leur inculquer les bonnes valeurs, pour leur faire atteindre la « Terre promise » du socialisme, même si tous ne pourront pas être sauvés (en lien avec la prédestination), ceux-là devant être éliminés. Les autres, les prolétaires, ont besoin de guides, car ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. Ces guides sont généralement austères et solitaires, n’hésitant pas à châtier, et se pensent seuls propriétaires de la gauche, comme puristes souhaitant faire triompher leurs idées sans transiger, par le biais d’une élite dirigeante bien organisée, mais sans culte populiste de la personnalité.
De l’autre côté, la gauche jésuite est souvent composée de « convertis » à la gauche, selon un modèle davantage pélagien qu’augustinien, se pensant donc majoritaire dans les masses, dont elles se préoccupent particulièrement, sans condescendance ni sentiment d’élitisme. Alors que la gauche janséniste a pour seule vocation la politique, la gauche jésuite considère qu’il ne s’agit que de la vie civile et que la vie entière ne s’y résume pas. Elle veut rendre son camp accessible à tous, et ne se méfie pas autant de la religion. En minorité au sein de la gauche, elle est cependant respectée par la droite, ce que la gauche janséniste ne lui pardonne pas.
Jacques Julliard admet qu’il s’agit là d’archétypes, que rares sont les hommes politiques de gauche à se rattacher entièrement à l’un des deux courants. Pourtant, je remarque que cette distinction peut aujourd’hui encore se trouver entre LFI et le PS : si LFI, par son attitude sectaire se considérant comme la seule véritable gauche, ne transige pas avec ses convictions, peut être rattachée à la gauche janséniste, le PS, par sa capacité au compromis et son ouverture envers ceux qui ne font pas partie de son camp, peut être relié à la gauche jésuite.
Concluons cette partie avec Michel Vovelle, historien de la Révolution : les Lumières, réformistes et non révolutionnaires, s’inscrivaient dans l’idée d’un absolutisme éclairé, et « vivaient dans les antichambres des rois » selon Robespierre lui-même. Pour autant, les gauches en tirent un héritage : la raison contre le fanatisme, la notion de progrès (des idées, de la civilisation, des sciences…), les libertés (de pensée et d’écrire, religieuse, individuelle…) contre le despotisme, l’individualisme contre les hiérarchies et les solidarités contraignantes. Ces idées s’enracineront à gauche sous la Révolution, par appropriation rétrospective ; mais toutes les Lumières ne seront pas considérées de la même manière, Robespierre s’attachant par exemple bien davantage à Rousseau, perçu comme plus démocrate, alors que Voltaire, Diderot et D’Alembert était vus comme des soutiens de la monarchie absolue profitant de leur position pour mener des vies confortables. Condorcet, en revanche, ainsi que les Girondins, embrassent davantage l’ensemble des Lumières2.
La Révolution française et la fondation de la gauche
A la Révolution, la gauche et la droite renvoient spatialement aux deux côtés de l’Assemblée : il ne s’agit pas encore d’essentialisation politique. Mais c’est de là que vient la fracture majeure du champ politique français, et l’organisation spatiale de l’Assemblée, en arc-de-cercle, de gauche à droite. Ainsi, l’Assemblée se regarde elle-même, se représentant à ses propres yeux. Le clivage gauche-droite s’ancre définitivement à partir du 28 août 1789, lorsque partisans et adversaires du veto royal se positionnent à droite et à gauche du président de l’Assemblée, sur cette question centrale de la souveraineté populaire – cette habitude persistera par la suite. Mais c’est bien la gauche qui prend l’habitude de se définir comme telle et de siéger à gauche ; la droite ne fait que suivre le mouvement, sans s’assumer en tant que droite, par peur d’une condamnation morale et de l’agression physique. Cette peur demeure aujourd’hui.
Le clivage n’est pas globalisé immédiatement ; d’abord, sous la Convention puis en 1848, le clivage n’est plus entre gauche et droite mais dépend de l’altitude. Les montagnards, révolutionnaires les plus avancés, siègent au plus haut ; les modérés de la Plaine ou du Marais, au centre ; et la Gironde, tout en bas. Ainsi, dans l’ouvrage collectif de Becker et Candar, Michel Vovelle rappelle qu’en 1788, les réformistes sont appelés « nationaux » en opposition aux « aristocrates » . Cependant, le clivage gauche-droite revient dans les assemblées du Directoire : les continuateurs de la Plaine au centre, les royalistes à droite, et les néojacobins à gauche.
Cependant, « être à gauche » désigne déjà, avant même le début de la Révolution, en 1788 lors de la campagne des États généraux, ceux qui soutiennent les réformes et s’opposent à l’arbitraire royal. Cela concerne principalement les élites bourgeoises, une partie de la noblesse libérale et le bas clergé éclairé. A partir de la Révolution de 1789, être de gauche signifie surtout adhérer au nouveau régime et reconnaître sa légitimité. Peu à peu, les réformistes modérés classés à gauche en 1788 basculent à droite par leur opposition à la radicalisation révolutionnaire : les monarchiens, royalistes modérés, sont dans ce cas de figure après le début de la Révolution, puis le parti constitutionnel (un centre favorable à la monarchie constitutionnelle) après la fuite du roi à Varennes à l’été 1791. Les Brissotins, devenus Girondins en 1792, représentent alors la gauche, comme les Jacobins ; puis, à leur tour, après l’avènement de la République en septembre 1792, ils sont rejetés à droite en 1793, puisque la ligne de clivage n’est plus celui de la réforme, puis de la monarchie constitutionnelle, ni même celui de la République, mais désormais entre les partisans de l’alliance avec les groupes populaires de la sans-culotterie (alliés aux Jacobins) et ceux qui s’y opposent, c’est-à-dire les Girondins.
La détestation des divisions menaçant l’unité nationale est un autre facteur expliquant le retard de l’essentialisation du clivage : on considère en général que le camp d’en face ne devrait pas exister. La dernière et essentielle raison est l’existence d’un centre, gouvernant le plus souvent, et instaurant un tripartisme sous la Révolution. Ainsi, à la Constituante, on trouve à droite les aristocrates et monarchiens comme Mounier (partisan de la prérogative royale), à gauche les futurs Girondins et Montagnards (Buzot, Robespierre), et au centre les patriotes constitutionnels menés par La Fayette et Mirabeau. Ce centre allié à la gauche domine la Constituante jusqu’à la fuite du roi à Varennes du 20 juin 1791. Après cet événement, Barnave et ses alliés quittent les Jacobins pour les Feuillants, dans une recomposition les plaçant à droite, tandis que Girondins, Jacobins et Cordeliers se trouvent à gauche.
Le centre correspond à la moitié des députés, et approuve la Révolution tout en craignant ses excès. Il est au gouvernement, avec la droite cette fois ; mais les Feuillants sont écrasés après le 10 août 1792 et la chute de la monarchie, ce qui repousse mécaniquement les Girondins à la droite de l’Assemblée. La Convention est dite girondine du 21 septembre 1792 au 2 juin 1793, avec le soutien du centre, qui soutient ensuite la gauche durant la Convention montagnarde de juin 1793 au 9 thermidor an II/27 juillet 1794, puis de nouveau la droite pendant la Convention thermidorienne de juillet 1794 à octobre 1795. Nous pouvons donc constater un tripartisme, même si les moments les plus décisifs opposent deux camps : c’est alors le centre qui fait la bascule entre les deux camps. Le centrisme, en France, serait donc plus fort lorsque la séparation entre gauche et droite s’accentue.
Cette séparation est très visible avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Cette dernière prend vite, même durant la Révolution, un caractère sacré, alors même qu’elle démolit les fondements de la société d’Ancien Régime, en particulier avec l’égalité des droits. Cette égalité s’ajoute à la liberté, contrairement à la Charte anglaise de 1215 : chacun a vocation à être l’égal des autres. La France se vidise désormais entre un camp favorable à l’égalité et à la liberté, et un autre qui y soumet des objections (sans oser s’y opposer de front, attitude typique de la droite qui ne formule que des objections de circonstance alors qu’elle rejette radicalement ce qui est proposé en réalité).
Le texte est pourtant composite, avec de nombreuses influences (Locke, Rousseau, Grotius, Constitution américaine)…, mêlant protection de l’individu contre l’arbitraire du pouvoir (droits de l’homme) et reconstitution d’un ordre politique nouveau (droits du citoyen). Le citoyen est à la fois un sujet à protéger et un souverain. La déclaration est à visée universelle, contrairement aux déclarations anglaise et américaine : c’est ce qui en fait un modèle pour tous les révolutionnaires, y compris les marxistes, et un contre-modèle pour les conservateurs. C’est un discours abstrait né des principes du XVIIIe siècle, rousseauistes, favorables à la souveraineté du peuple. Ce simple principe est rejeté par les conservateurs, qui ne peuvent s’y opposer directement du fait du climat révolutionnaire, jusqu’à la contre-révolution du début du XIXe siècle à travers Bonald par exemple, qui proclame plutôt les droits de Dieu.
Les droits proclamés sont dits « naturels » : les Girondins considèrent que c’est une référence à l’état de nature, et les Montagnards (ainsi que les révolutionnaires de 1789) que ces droits sont plutôt inhérents à la nature de l’homme, vu comme immédiatement social. Marx, comme les Girondins et Condorcet, pense que ces droits sont artificiels et construits. Cependant, tous se retrouvent dans cette déclaration, alors que la droite y trouve des excès. La droite s’oppose aussi à la notion de souveraineté populaire également proclamée, et elle ne l’accepte qu’un siècle plus tard, sous la IIIe République, en dépit de l’opposition maurrassienne. L’idée de devoirs, que les conservateurs veulent affirmer dans une déclaration séparée, n’est cependant pas absente de la déclaration, ni même de la pensée de Robespierre par exemple ; pourtant, cette notion reste attachée à la droite, qui met en avant des devoirs envers Dieu, et envers la société après Bonald. Quoi qu’il en soit, les droits proclamés ne vont pas jusqu’à mettre en place des mesures pratiques pour résoudre la question sociale, et le droit de propriété est bien affirmé, bien qu’en retrait par rapport aux autres. La question sociale n’est à cette époque pas au cœur du clivage gauche-droite.
L’élément le plus révolutionnaire de la période est le transfert de la souveraineté du roi au peuple, à partir du 17 juin 1789, lorsque l’Assemblée se proclame nationale et donc seule légitime pour interpréter la volonté générale de la nation, ce à quoi Louis XVI se résigne le 17 juillet en acceptant la cocarde tricolore. Toute la suite de la Révolution, puis la plupart des régimes successifs, entérinent ce nouvel état, proprement révolutionnaire. Le principe de souveraineté du peuple est cependant diffus, comme l’avait été avant lui celui de souveraineté royale, plus ou moins illimitée. Avec le roi, la souveraineté s’incarne, littéralement, en un souverain ; mais quand le dépositaire de la souveraineté est une personne morale, cette souveraineté est abstraite. Si le peuple est souverain, il se commande à lui-même, mais à distance, par le biais de la représentation, ce qui est le cœur du problème démocratique. Le 17 juin 1789, c’est l’Assemblée qui se proclame de fait souveraine, contre les principes rousseauistes, même si affirme en théorie que c’est le peuple qui est souverain. Rousseau, lui, aurait voulu que le peuple exerce lui-même sa souveraineté, chose impossible, d’où l’échec de la Révolution et l’instabilité politique de deux siècles qui s’en est suivie.
Le débat sur le veto représentatif illustre cette question. Trois camps se font face : la souveraineté représentative défendue par Sieyès, la souveraineté directe par Robespierre, et la souveraineté mixte par les Monarchiens comme Mounier. Sieyès veut séparer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, s’opposant donc au veto, puisque l’Assemblée est dépositaire de la volonté nationale et non le roi. Il affirme légitime l’assemblée représentative, le peuple étant incapable de s’exprimer autrement – comme Dieu vis-à-vis du roi dans la monarchie de droit divin. Le seul moment où le peuple exerce sa souveraineté est donc l’élection. Robespierre est opposé à cette notion, y voyant une confiscation du pouvoir du peuple, tout en étant défavorable au véto, au nom de la volonté nationale. Les monarchistes modérés, enfin, dont Mirabeau font partie, craignent l’apparition d’une aristocratie issue de l’élection, préférant au contraire une alliance entre le roi et le peuple : les Monarchiens sont donc favorables au véto, même si Mounier admet la souveraineté nationale et le principe de représentation. Il s’oppose donc au risque « d’accaparement de la souveraineté » par les représentants, et veut un exécutif fort contrôlé par le roi comme arbitre, permettant une séparation des pouvoirs, alors que Sieyès prône leur indivisibilité.
Le débat donne naissance aux modèles actuels de la souveraineté du peuple : le modèle populaire (sans délégation), le modèle parlementaire (avec une assemblée élue), et le modèle monarchique ou présidentiel (où la délégation de souveraineté est divisée entre l’assemblée et le chef d’État). Le modèle populaire est notamment défendue par les Jacobins ; pour autant, ils ont eux aussi recours à la délégation, avec une faction se proclamant représentative du peuple. Ainsi, les élites « démocratiques » s’auto-sélectionnent, comme en URSS ensuite. Sous la Convention montagnarde, l’Assemblée est sous pression de la guillotine : elle n’est pas souveraine. Condorcet, au contraire, prévoyait un système semi-direct, par un renouvellement annuel du corps législatif, une élection directe du gouvernement, une révision périodique de la Constitution… permettant des rapports plus réguliers entre le peuple et sa représentation, avec un contrôle continu. Irréalisable, la démocratie directe est pourtant un objectif essentiel, ce qui suscite en permanence le débat public et l’action politique. Le mouvement ouvrier et le socialisme se révoltent ainsi contre la démocratie bourgeoise qui confisquerait la souveraineté du peuple. Initialement, l’opposition entre souveraineté du peuple et souveraineté royale divise la gauche et la droite ; aujourd’hui, la droite s’est ralliée à la souveraineté du peuple, et le débat oppose délégation au Parlement et souveraineté semi-directe exercée par le Président. Orléanistes parlementaristes s’opposent ainsi aux bonapartistes à droite, alors qu’à gauche les modérés soutiennent le Parlement, contre les plus radicaux qui préfèrent « un mélange de soviétisme et de charismatisme » .
Une philosophie de gauche, républicaine, est née de la Révolution au fil de son développement : les droits de l’homme sont affirmés comme but ultime de la politique, la République est considérée distincte de la démocratie et de la souveraineté populaire, la neutralité religieuse est adoptée, et l’instruction publique est désirée pour tous et au service de la collectivité. Ces quatre principes sont ainsi l’essence de la Révolution, suscitant la contre-doctrine des contre-révolutionnaires que nous avons déjà pu étudier dans d’autres articles. Des nuances apparaissent aussi au sein de la gauche, avec les mêmes principes mais des pratiques différentes : une culture centralisatrice issue du jacobinisme valorisant le rôle de l’État dans la société, protectionniste voire nationaliste, à laquelle la classe ouvrière adhère ; et la deuxième gauche, opposée au principe d’autorité, souhaitant la décentralisation, les initiatives de la société civile, la défense du droit des minorités, l’autonomie des collectivités… Ces deux cultures se côtoyant parfois au sein des individus eux-mêmes, même si la première est en général dominante, tandis que la seconde influe surtout par ses idées et par délégation. Méfiante envers la représentation, la deuxième culture lui préfère la démocratie directe et les avant-gardes révolutionnaires. Ainsi s’opposent centralisation jacobine issue de la monarchie absolue et monde associatif issu de la société d’Ancien Régime et fondé sur les particularismes. Pour la religion, la Révolution est contradictoire, ayant proclamé la liberté de conscience et de culte mais ayant reconnu la prépondérance du catholicisme à travers la Constitution civile du clergé : tradition gallicane favorable à l’Église et partisans de la séparation (ancêtres de la IIIe République) se font face. Pour la scolarité enfin, la première culture veut rendre les enfants au service de l’État pour en faire des citoyens et soldats, alors que la seconde veut leur permettre l’épanouissement.
En effet, selon Jacques Julliard, la République est en premier lieu une idée, un thème abstrait, qui désignait avant la Révolution l’État de l’Ancien Régime, fondé sur des règles juridiques et se rendant donc légitime. Jean Bodin, dans son ouvrage La république (1576), lie ainsi république et l’idée d’un « droit gouvernement » fondé sur un ordre juridique et détenant un pouvoir suprême (souverain et perpétuel). Pour Rousseau, une République se caractérise par des lois et la défense de l’intérêt public : il n’existe pas de séparation entre monarchie et république dans ces conditions. Montesquieu, en revanche, sépare les deux comme deux formes de gouvernement différentes, la république étant considérée comme un régime impliquant une pluralité de gouvernants, sur des bases démocrates ou aristocrates. L’élection, pour Montesquieu, est cette forme aristocratique de la république : le peuple choisit à qui confier l’autorité, ne sachant pas l’exercer lui-même. Le système représentatif électif serait donc aristocratique ; seul un système de tirage au sort serait démocratique selon Montesquieu, là où Rousseau prône la démocratie directe.
Le système représentatif est en réalité nécessairement aristocratique : l’idée de démocratie représentative serait donc illusoire, puisque les élus s’arrogent dans la pratique la souveraineté du peuple. Même les Lumières défendaient la monarchie constitutionnelle à l’anglaise, et pas la République moderne. En revanche, les révolutionnaires sont républicains en ce qu’ils proclament l’égalité des droits et l’appropriation collective de la souveraineté, ainsi que la limitation de l’autorité du roi et l’institution de pouvoirs représentatifs, même s’ils sont au départ favorables au maintien de la monarchie. Ainsi, les républicains en tant que tels sont surtout Girondins, notamment Condorcet, alors que les Jacobins sont au départ plutôt monarchistes. En effet, les Jacobins sont favorables à la concentration des pouvoirs, alors que les Girondins veulent éviter la tyrannie et le déséquilibre des pouvoirs. La République n’est instaurée que par truchement, par l’abolition de la monarchie : elle n’est pas proclamée, son existence est juste admise, comme au début de la IIIe République. Intégrée à un imaginaire de complots et de violences, la République est à partir de la Restauration considérée avec méfiance, avant d’être proclamée en 1848 devant l’absence d’alternative.
La Révolution souhaitant faire table rase, elle doit s’intéresser à l’éducation, tant comme objectif (la transformation de la société pour la rapprocher de l’idéal) que comme moyen de poursuivre la Révolution en ralliant la majorité aux activistes pour régulariser le nouvel état des choses. C’est l’origine de la mystique pédagogique de l’époque, qui devient une véritable obsession, avec des centaines de projets de réforme de l’enseignement. Mais c’est l’éducation qui prime : la formation des esprits est jugée plus importante que l’acquisition des connaissances, car l’objectif est d’abord de former des citoyens, pour façonner un peuple nouveau. Car en république, contrairement à une démocratie où le peuple a toujours raison, il est soumis à des obligations politiques et de résultats. Talleyrand, dans son rapport sur l’instruction publique, affirme ainsi que transmettre la Constitution doit être le principale objectif de l’instruction ; aujourd’hui, c’est d’apprendre à lire, écrire et compter. Mirabeau a la même opinion, comme Rabaut Saint-Etienne, etc. Lepeletier de Saint-Fargeau s’inquiète même des premières années des enfants au sein de leur famille.
L’objectif de la politique éducative est ainsi de transformer les nouvelles générations en servantes de l’État, détachés de leur famille. L’éducation est aujourd’hui un « service public » au bénéfice des citoyens, mais à cette époque, elle est conçue comme devant servir la collectivité nationale. C’est un véritable baptême laïque, pour forger par une éducation austère et civique un homme nouveau – l’expression est de Saint Paul. Une idée très partagée, notamment par Barère du Comité de salut public, est que les enfants doivent d’abord appartenir à la république, avant d’appartenir à leur famille, à laquelle ils devraient être retirés, littéralement. Ce projet utopique se rapproche de l’histoire spartiate, avec une société reposant sur la discipline et le militarisme. Cependant, c’est un programme qu’on pourrait qualifier d’inhumain, et les projets suivants prévoient une éducation commune gratuite mais non obligatoire.
La conception la plus radicale, étatiste, disciplinaire, misérabiliste, est pessimiste en ce qu’elle croit nécessaire de contrôler le peuple. Holiste, elle vise à subordonner l’individu à la société, en s’inspirant de Sparte, dans une logique réellement totalitaire, allant plus loin que tout ce qui viendra à sa suite, dans l’espoir d’une nouvelle Genèse, par un exercice « prométhéen et sacerdotal » du pouvoir. L’autre conception de l’homme nouveau est plus libérale : c’est celle de Condorcet et Talleyrand, qui approuvent l’idée de progrès continu, et d’une liberté de l’enseignement, à la fois pour ne pas provoquer le mécontentement et par conviction que la contrainte est incompatible avec l’éducation. En matière de doctrine, cependant, tous sont d’accord sur l’enseignement d’une morale universelle, à l’origine de la laïcité à la française ; et la gratuité est de même approuvée, pour démocratiser les connaissances à égalité. Mais la querelle sur les visées principales, de connaissances pures ou d’enseignement civique, n’est pas tranchée.
Au début de la Révolution, le bas clergé, majoritaire dans son ordre aux États généraux, soutient les revendications populaires, et c’est lui qui provoque le vote par tête et la fusion des ordres, ce qui mène à la Constituante. Les dîmes et casuels qui financent le clergé sont supprimés la nuit du 4 août, ce qui rend inéluctable la fonctionnarisation des ecclésiastiques ; le 2 novembre, Talleyrand (alors évêque) propose de nationaliser les biens de l’Église, puis l’Assemblée refuse de proclamer le catholicisme religion d’État. L’étau se resserre, alors que la religion catholique entre dans un processus de désinstitutionnalisation : c’est le début du conflit, qu’exacerbe la Constitution civile du clergé à l’été 1790, prévoyant notamment l’élection des évêques et curés, transformant le culte en service public. Le pape Pie VI n’est pas impliqué dans les négociations, alors qu’elles mènent à la nationalisation de l’Église, et il condamne la Constitution civile le 10 mars 1791 en publiant le bref Quod Aliquantum. L’Assemblée représentant la nation s’octroie le droit de légiférer sur la religion, en dehors de l’avis de l’Église. La plupart des évêques, et la moitié du clergé paroissial, refusent de prêter serment de fidélité à la nation, et une partie de la paysannerie, notamment dans l’ouest, se soulève en soutien de leurs prêtres. C’est seulement à partir de ce moment-là que la rupture est consommée entre gauche et religion, alors que la droite s’allie au catholicisme.
A gauche, trois types de comportements vis-à-vis de la religion existent. On trouve à l’origine de la Constitution civile le gallicanisme reconnaissant la prédominance du catholicisme et cherchant donc à le contrôler en s’inscrivant dans le courant de Bossuet affirmant la souveraineté temporelle des princes et la limitation des pouvoirs du pape, sans séparer l’Église et l’État. Contradictoire, ce courant dépérit avec la Constitution civile. Le deuxième type est celui de l’esprit laïque, refusant de changer la religion par l’Assemblée : ainsi les Girondins, souvent anticléricaux, encyclopédistes et républicains, mais attachés aux libertés publiques, par exemple avec Condorcet. Leur objectif est ainsi la séparation du religieux et du politique. L’athéisme militant, enfin, veut déchristianiser la France : c’est un courant représenté par Fouché et les hébertistes comme au sein de la Commune de Paris par exemple, la déesse Raison étant préférée à Dieu, les instruments du culte étant par ailleurs profanés, ce qui choque les populations et déconsidère le mouvement révolutionnaire. Cependant, rejeter la religion dans le privé a signifié l’expulsion de la puissance publique hors de ses affaires, ce qui contribue à sacraliser la religion – tout comme les persécutions ne font que fortifier la croyance, alors que la prospérité l’affaiblit au contraire. Bonaparte le comprend, et revient donc au gallicanisme par le Concordat.
En conclusion de cette Révolution, nous pouvons constater des dissensions au sein même de la gauche, dès cette époque. Ces dissensions préfigurent les grands courants des siècles suivants : la gauche libérale, la gauche jacobine, la gauche collectiviste et la gauche libertaire. La gauche libérale a ainsi été étudiée par de nombreux historiens : Thiers, Guizot, Tocqueville, Marcel Gauchet, Pierre Rosanvallon, François Furet… qui considèrent que le sens de l’Histoire menait la France à 1789, mais pas à 1793. La Révolution mène légitimement la bourgeoisie au pouvoir, ce qui serait un optimum démocratique. L’autre tradition historiographique est celle valorisant plutôt 1793 : c’est l’histoire jacobine, avec Louis Blanc en premier lieu, et Robespierre en figure de proue. Attachés à la société d’individus (contrairement au marxisme), elle défend aussi un État central puissant, comme sous le Comité de salut public, et l’Ancien Régime avant lui, le peuple étant désormais le souverain à la place du roi, ce cadre constitutionnel et administratif ayant été accueilli, et conservé aujourd’hui par l’intermédiaire du général de Gaulle. Les socialistes, comme Jean Jaurès, pensent par ailleurs que la logique démocrate de 1793 devait mener à une égalité réelle, dans un régime socialiste. La quatrième famille, des libertaires, est notamment représentée par un ouvrage de l’anarchiste Daniel Guérin (1904-1988), qui voit en la Révolution un mélange entre une révolution bourgeoise et un début de révolution permanente opposant les masses et les élites.
Sur la religion aussi, les historiens de gauche divergent ; étonnamment, les libéraux qui critiquent les persécutions politiques se trouvent ici, comme Edgar Quinet (1803-1875), à regretter que les révolutionnaires ne soient pas allés plus loin dans la déchristianisation. La Révolution était en effet une affaire religieuse, reprenant de plus nombre de rites catholiques en les laïcisant, avec l’idée de porter un nouvel Évangile selon Quinet. L’évêque constitutionnel Fauchet affirmait en effet que Jésus avait été crucifié par l’aristocratie, et l’historien catholique Buchez (1796-1865) est dans le même temps un admirateur de Robespierre, qui ménageait lui-même le sentiment religieux.
Ainsi, la Révolution est qualifiée d' »événement-matrice » qui serait advenu au terme de causalités particulières dépassées par la construction qu’elles entraînent, et dont les représentations forgent les lignes de fracture qui s’ensuivent. Si la gauche s’unit autour de l’approbation de la Révolution, elle se divise donc dans son interprétation. Elle se divise d’abord entre république (principe national d’unité) et démocratie (principe populaire de diversité), entre système représentatif par le biais d’une assemblée nationale unique et éloge des corps intermédiaires et aux intérêts particuliers. Le système représentatif triomphe, mais la démocratie directe s’exprime aussi, notamment par la démocratie sectionnaire de 1793. La gauche se divise aussi entre centralité étatique et décentralisation, unité nationalite et fédéralisme. La droite s’empare des « libertés locales » contre l’étatisme de la gauche : c’est l’un des piliers du maurrassisme. Les courants décentralisateurs de la gauche, qui existent aussi, ne s’affirment qu’à la fin du XXe siècle avec la deuxième gauche et notamment François Mitterrand. Comme troisième point de discorde, la république libérale s’oppose également à la république sociale : malgré la suppression consensuelle des corporations par les révolutionnaires, la guerre fait évoluer la situation, et des lois réglementant le commerce des denrées de première nécessité sont mises en place, ce qui est un échec mais marque le début d’une vision socialisante de la Révolution. Comme nous l’avons vu, le débat existe aussi entre éducation et instruction, sur la finalité de l’école : la discussion est encore ouverte aujourd’hui, entre savoir et méthodes d’apprentissage, structures mentales et moyens de parvenir à des fins, les pédagogistes s’opposant aux classiques libéraux. Enfin, pour la question religieuse, la gauche se divise entre gallicans et soutiens de la séparation, ou même entre contrôle et éradication. La solution trouvée notamment par Aristide Briand au début du XXe siècle règle la question : c’est la laïcité.
Sous la Révolution existe déjà l’obsession de l’unité, et l’accusation de division, qui précipite notamment la chute des Girondins. La Révolution divise bel et bien la France, mais ce n’était pas du tout l’intention des révolutionnaires. En effet, le principe d’unité est omniprésent, comme il l’avait été sous l’Ancien Régime : le principe de souveraineté demeure. Après l’unification du royaume autour du roi sous la monarchie, la Révolution veut que la démocratie soit associée aux idées d’unité et de souveraineté, dans la même lignée. Le fossé est pour autant béant, entre soutiens et opposants à la Révolution, l’ancienne légitimité ne disparaissant pas complètement des représentations, la légitimité dynastique persistant partiellement jusqu’à la fin du XIXe siècle. Les combats politiques qui devaient suivre, sur la question institutionnelle, la question religieuse, et la question sociale, sont tous issus de la Révolution
Unité et discorde se mêlent ainsi dans la vie politique française du XIXe siècle, conduisant à l’idée que le camp d’en face n’est en réalité même pas légitime dans son existence : la division gauche-droite est considérée en France comme illégitime, car elle devrait dans l’idéal ne pas exister, l’autre camp étant perçu comme le mal, d’un point de vue éthique, et il faudrait donc l’éliminer. D’où les méfiances persistantes de la gauche pour la démocratie, qui fait s’exprimer la diversité des opinions ; c’est seulement aux débuts de la IIIe République que le pluralisme est considéré comme une situation normale. L’idéal unitaire ne disparaît pas pour autant.
Historiquement, la gauche est le camp de ceux qui acceptent la Révolution, et la droite, celui de ceux qui la refusaient ; mais aujourd’hui, la droite s’est résignée à l’accepter, illustrant l’épuisement du clivage gauche-droite. Fondamentalement, les deux camps sont déséquilibrés : la gauche se caractérise dès ses origines par l’adhésion au projet révolutionnaire, et la droite, seulement par son refus, alors même que la Révolution a donné naissance à notre société contemporaine. La droite souffre donc d’un déficit de légitimité, contrairement à la gauche, dont le patrimoine philosophique a réussi à se faire celui de la nation. Sa légitimité est historique dans la France contemporaine ; celle de la droite n’est que sociale, s’appuyant sur l’autorité et l’ordre. Ces deux légitimités s’affrontent ainsi, encore aujourd’hui. On peut jusqu’en 1920 se dire de gauche en se réclamant simplement des droits de l’homme, même si par la suite, les marxistes prennent l’ascendant et mettent la question sociale au cœur du débat, scindant la gauche en deux, entre principes politiques et valeurs sociales, jusqu’à la fin du communisme. La droite, en revanche, ne peut exister en autonomie que par le refus radical de la Révolution – ce qu’elle n’ose pas faire. Elle ne reste, selon les termes de Jacques Julliard, qu’une non-gauche. Une culture de gouvernement, issue aujourd’hui de l’orléanisme, rejetant le clivage gauche-droite et se réclamant du « centre » – c’est-à-dire, « une droite qui ne s’aime pas » .
Conclusion
Arrêtons-nous là pour le moment. L’histoire des gauches naît donc au XVIIIe siècle, par les Lumières (de façon certes rétrospective) puis par la Révolution. La gauche, c’est d’abord l’adhésion au concept de progrès, d’amélioration continue de l’humanité vers l’unité et la fin des inégalités par le perfectionnement physique, intellectuel et moral ; et cette idée de progrès, c’est celle des Lumières, qui placent la science au service de la justice et de l’égalité, comme les révolutionnaires envisageront l’éducation comme leur cœur de projet démiurge de transformation de la société. L’étatisme, l’idée d’une politique démiurge par le biais de l’État, deviendra plus tard une idée de gauche, mais on peut aussi y voir ses origines à cette époque, lors de la naissance de l’opinion publique, contestant les choix du gouvernement royal, et désirant des réformes.
Pour autant, c’est aussi dans ce siècle qu’on trouvera les origines des fractures au sein-même de la gauche, principalement entre sa fraction modérée, tolérante, attachée à la liberté de pensée et l’esprit critique, et sa fraction radicale, qui considère que les droits de l’homme sont un subterfuge bourgeois, et qui sont prêts à accepter des limitations de la démocratie au nom d’un idéal progressiste et unitaire.
Ces divisions se trouvent aussi dans les différentes inspirations des gauches : une gauche inspirée du jansénisme augustinien, aristocrate d’esprit, élitiste, intransigeant, et pessimiste sur la nature de l’homme, et une gauche inspirée par le jésuitisme thomiste, plus ouvert au peuple, optimiste, universaliste, associé aux Lumières, sans rigorisme.
La Révolution réunit ces éléments pour donner naissance à la gauche contemporaine, même si elle ne se désigne pas immédiatement comme gauche. Malgré les nuances (entre république et démocratie, centralité étatique et décentralisation, république libérale et république sociale, éducation et instruction, et gallicanisme et séparation de l’Église et de l’État), les traits caractéristiques de la gauche se développent alors : la volonté d’accomplissement des droits de l’homme par la politique, d’instaurer une instruction publique collective, la neutralité religieuse, la souveraineté populaire. En effet, l’acte le plus révolutionnaire de l’époque, caractérisant en premier chef la gauche, est le transfert de souveraineté, du roi vers le peuple : la droite ne peut qu’entériner cet état de fait, et garder à jamais un temps de retard sur le camp adverse.
On peut voir, encore aujourd’hui, des traces significatives des origines philosophiques et révolutionnaires des gauches. La souveraineté populaire a évidemment été acceptée par l’ensemble du champ politique : personne ne remet en cause le suffrage universel ni la notion de volonté du peuple comme fondement de la légitimité. La droite se trouve alors dans une situation paradoxale : issue historiquement d’un courant par définition contre-révolutionnaire, elle ne peut aujourd’hui assumer cet héritage incompatible avec notre système de valeurs, et ne peut que dissimuler ses propres origines, et défendre ses idées sans pouvoir être pleinement elle-même. Le magistère moral des gauches, qui date du XVIIIe siècle, persiste aujourd’hui. Mais leurs divisions aussi : purisme contre compromis, laïcité contre acceptation du fait religieux, République sociale contre libérale, démocratie représentative contre démocratie directe… tous ces débats traversent les gauches, et contribuent à recomposer le paysage politique.
Nous verrons dans les articles ultérieurs la suite de l’histoire des gauches, d’abord au cours du XIXe siècle.
