La science politique, nous l’avons déjà vu, consiste en une analyse de la politique : après avoir constaté que l’ordre social n’est pas inné, il s’agit de comprendre le fonctionnement des structures politiques et d’interroger ses propres convictions. Rien, en politique, n’est universel, y compris les formes d’organisations : la délégation du pouvoir, élément essentiel de toute division du travail entre gouvernants et gouvernés, prend des formes différentes à travers le temps.
La science politique, qui cherchait à la fin du XIXe siècle à instruire les grands serviteurs de l’État pour leur transmettre une connaissance de la statistique et une expertise d’État, n’est devenue une véritable science institutionnalisée qu’à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’étude de la politique, jusqu’à Max Weber au début du XXe siècle, consiste à considérer ses fonctions, affirmées comme intemporelles : définir le « groupe » par ses frontières et valeurs, revendiquer l’appropriation d’un territoire, organiser les « pouvoirs publics » , dénombrer la population, et plus largement, organiser la vie en société et maintenir l’ordre. Cependant, Max Weber, considérant qu’on ne peut donner aucun contenu spécifique au domaine politique (puisqu’on peut parler tant de la politique d’un syndicat que de la politique scolaire par exemple), préfère définir la politique par les moyens, en l’occurrence l’État, qui utilise la violence (monopolisée) pour exercer le pouvoir et établir sa domination sur son territoire.
L’État, dans nos sociétés modernes, est ainsi au cœur de tous les différents aspects politiques des enjeux liés à notre organisation commune ; mais dans le même temps, il n’est pas le seul groupement politique à avoir touché à la « chose » politique. C’est pourquoi, selon Weber et ses successeurs, la science politique réside dans l’analyse de l’accumulation des processus passés donnant lieu au présent, des processus parfois concurrents. L’objet de cette science serait donc, non plus les fonctions intemporelles de la politique, mais une enquête sur la genèse des structures comme l’État dont le contrôle est au cœur de l’affrontement des groupes luttant pour le pouvoir. Étudier les questions institutionnelles, et l’histoire des groupements politiques, est ainsi essentiel à la science politique.
C’est pourquoi, dans cet article qui inaugure une série de douze articles portant sur les principaux objets d’étude des sciences politiques, nous étudierons les genèses des groupements politiques. Pour ce faire, je me servirai du Nouveau manuel de science politique1, dont la dernière édition est parue en septembre 2024.
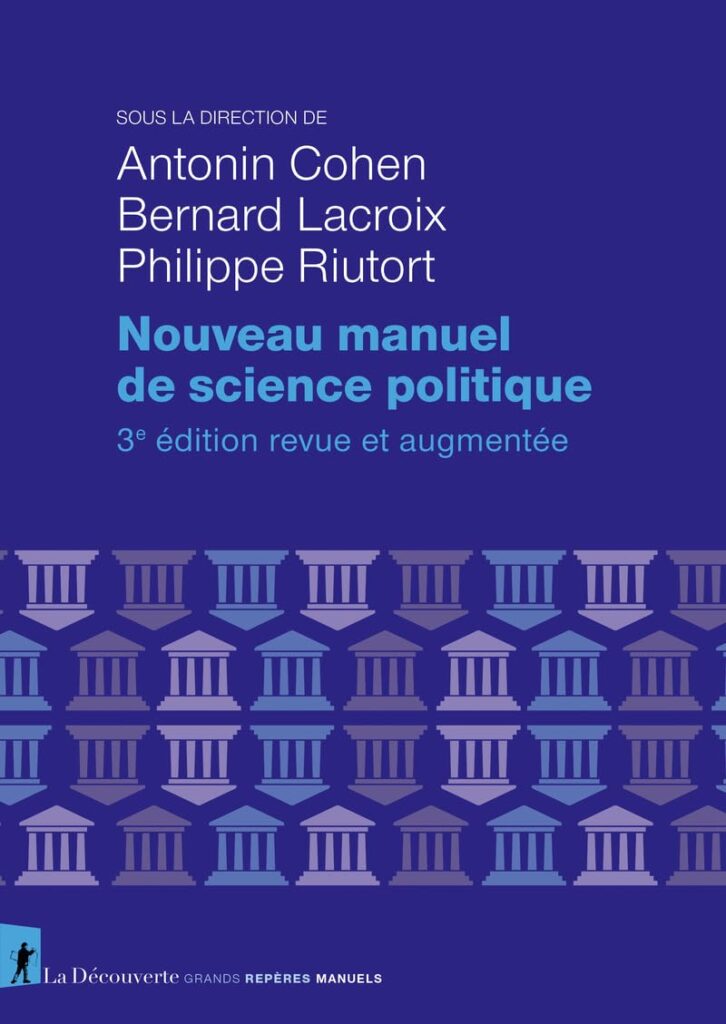
L’État : une évidence ?
Le terme d’État est aujourd’hui universellement employé pour désigner les groupements politiques souverains (en théorie) sur un territoire donné et qui y exercent le pouvoir politique, quelle que soit l’origine de ce pouvoir. Pourtant, ces groupes sont particulièrement diversifiés, tant dans leur organisation que dans leur culture, leur taille, ou leur puissance ; et cette forme étatique, aujourd’hui évidente, ne l’a pas toujours été, dépendant des représentations collectives et de leur évolution, en constante réinvention.
Comprendre l’État implique donc d’étudier le processus historique de sa construction, sa philosophie, les représentations qui l’ont fait advenir, en le réinscrivant dans une histoire au long cours marquée par des réalisations comme des frontières, et des « grandes dates » perçues comme telles de façon rétrospective. Norbert Elias parle ainsi d’une « sociogenèse de l’État » pour aborder l’histoire politique française entre le XIe siècle et le XVe siècle, et étudier les représentations du pouvoir ou encore les conflits entre lignées à travers le prisme des transformations des relations entre unités de puissance, menant à ce qu’un monopole de domination se stabilise au sein de l’État, exerçant son pouvoir sur une population au sein d’un territoire donné. Ce qui est aujourd’hui évident a donc été un résultat historique.
Vie et mort des groupements et des formes politiques
Selon Xavier Landrin, les formes et les groupes de la politique évoluent en effet : c’est seulement au XVIe siècle que la politique (comme pratiques inscrites dans des systèmes de relations que s’approprient des groupes) apparaît en tant qu’espace indépendant des pouvoirs religieux, tandis que les États émergent. Des groupes comme la noblesse investissent cet espace, chacun avec son historicité, pour faire advenir des formes sociales spécifiques telles que des institutions ou d’autres entités comme la nation : ces formes deviennent des enjeux de luttes majeurs.
La construction de l’ordre féodal
L’ordre féodal se stabilise entre les XIe et XIVe siècles, autour de la forme des seigneuries châtelaines dispersant les pôles de puissance, mais aussi d’un centre politique incarné par le pouvoir monarchique : cette apparente contradiction caractérise la société féodale et est à l’origine du développement des États, à travers les réseaux de fidélité féodo-vassaliques. Les interdépendances se redéfinissent donc, et les formes de pouvoir dissemblables et groupements concurrents rentrent en tension, menant à des entreprises symboliques de restauration de l’ordre social.
En effet, à partir du IXe siècle, le pouvoir carolingien s’effondre à cause de l’indépendance croissante des auxiliaires du pouvoir, qui s’approprient les biens légués par le roi en tant que patrimoine transmissible, menant à la formation de principautés locales fondées notamment sur la puissance des forteresses, le pouvoir de commandement et la vassalité. L’autorité publique se fragmente ainsi avec le droit de commander et de punir, et des pôles de puissance se reconstruisent au sein des seigneuries châtelaines, menant à la reconstruction d’un ordre social autour de nouvelles pratiques d’allégeance comme la cérémonie de l’hommage : le vassal, contre une terre assurant sa subsistance, promet de venir en aide à son seigneur.
Cependant, les souverains cherchent à récupérer leurs prérogatives grâce au droit féodal et à leurs réseaux vassaliques, par exemple en imposant la justice royale pour arbitrer les conflits entre vassaux et seigneurs. Ils rétablissent une « fiscalité monarchique » au début du XIIIe siècle et font bénéficier à la monarchie le système féodal, les rois étant reconnus seigneurs suprêmes, tout en recevant un sacre qui les légitime, et en utilisant le droit romain pour justifier une souveraineté royale extérieure à l’ordre féodal grâce à l’Église.
L’espace structuré par la seigneurie châtelaine l’est donc ensuite par les monarchies féodales, du fait de l’essor du pouvoir royal. Les groupes se stabilisent dans leur rôle du fait des modes de reproduction de l’ordre social par les instruments symboliques du droit et de la généalogie (et par des rites et pratiques) : le servage se transmet ainsi héréditairement, comme la noblesse, dont les modalités d’accès se restreignent, de l’acquisition d’un fief à l’héritage pur et simple, renforçant l’aristocratie à partir du XIIIe siècle par des ordonnances royales. L’univers social et ses divisions sont stabilisés par des principes de classement, en particulier l’idéologie des « trois ordres » dès le XIe siècle (puis au XIIIe) divisant symboliquement la société entre ceux qui prient, combattent, et travaillent. Les groupes dominants sont ainsi renforcés. Sous le règne de Philippe II (1180-1223), ceux qui travaillent deviennent ceux qui négocient, et les gens du peuple s’agitent alors que le système seigneurial est contesté ; cependant, le roi, le clergé et les chevaliers maintiennent le modèle tripartite, en s’aidant d’une « idéologie des sociétés » .
Cette société féodale repose sur des traditions et systèmes symboliques de classement qui permettent la production continue et ritualisée d’un ordre de domination spécifique. Le « mouvement communal » , d’abord issu de la fragmentation de l’autorité publique, s’affirme comme une rupture vis-à-vis de la féodalité, puisqu’il s’agit de communautés urbaines autonomes et laïques plutôt que d’autorités cléricales et aristocratiques.
Les rapports de forces entre groupes dominants se redéfinissent : puisque les revenus de la couronne augmentent, les rois peuvent fidéliser la noblesse, et étendre la puissance des baillis contre les grands fiefs.
L’invention du passé national
Des mises en forme du passé se déploient, entre réalisations (pratiques, institutions…), qualifications rétrospectives (ces réalisations devenant des enjeux d’interprétation). Les visions légitimatrices de l’ordre social sont concurrentes, mais les cultures nationales se formalisent au XIXe siècle, ces visions et cultures ayant chacune un rapport particulier au passé utilisé pour reconstruire l’autorité des fractions dominantes. Au début de ce siècle, le présent est considéré comme un temps de transition tourné vers l’avenir et caractérisé par la lutte de la société nouvelle contre l’ordre ancien, l’anachronisme se confrontant à l’anticipation et produisant un sentiment d’attente, dans le cadre de ce régime d’historicité particulier.
Cette historiographie est soutenue par les intellectuels libéraux au fort rayonnement institutionnel (comme Guizot), opposés à l’historiographie de la chronique officielle des gouvernements. La nouvelle historiographie, favorisée par le monopole des producteurs savants libéraux des milieux politiques, académiques ou journalistiques, forge une histoire tournée vers l’ascension des classes moyennes (notamment de la bourgeoisie des communes) contre les élites nobiliaires, de la féodalité jusqu’à la Révolution. Les communes bourgeoises, en effet, étaient considérées comme le fer de lance de l’émancipation des libertés contre l’arbitraire féodal. En revanche, le discours nobiliaire fonde son discours sur des essais des XVIIe et XVIIIe siècles, et une lecture homogène de l’histoire considérant que l’origine du pouvoir de la noblesse est issu du triomphe franc sur les Gallo-Romains au VIe siècle, l’aristocratie germanique ayant vaincu le « peuple » .
La nation, nouvelle forme collective émergeant à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, repose sur l’historiographie libérale, nécessitant un passé collectif recréé et se proposant comme nouvel espace de croyances : elle nécessite la désagrégation des sociétés où préémine un centre politique, ainsi que la fragmentation du monde chrétien, et la fin d’une vision cyclique du temps et d’une conception cosmologique des destinées humaines. Les nations se renforcent avec les États et par des phénomènes de construction symboliques, par exemple grâce à la circulation des langues vernaculaires officielles, aboutissant en la création d’espaces de communication favorisant l’identité nationale et l’autonomie culturelle. Un nouveau cosmopolitisme culturel, non fondé sur un universalisme imposé mais sur les spécificités nationales. Une langue nationale s’impose au détriment des langues de terroir, des productions culturelles de masse circulent comme les journaux, les luttes entre groupes sociaux se rationalisent par l’historiographie, le rapport au temps se synchronise par les politiques publiques (sur le temps de travail par exemple), les solidarités locales se nationalisent, la nation est ritualisée…
Genèses et constructions de l’État moderne
Pour Bernard Lacroix, l’État se construit notamment par un vocabulaire précis, comme idéologie sociale véhiculée par les langages d’État. Il s’agit de termes tels que « nation » ou « souveraineté » , ayant fait l’objet de luttes dans leur usage, avec des définitions historiquement situées. Ces catégories d’État, aujourd’hui encore utilisées, ne doivent pas être considérées de façon anachronique – bien que l’État soit lui-même fondé en partie sur des anachronismes et des constructions rétrospectives ignorant les modalités historiques de sa formation. Sous la IIIe République, on présente ainsi l’histoire française comme tendant naturellement vers la formation d’un État épousant les « frontières naturelles » de la France, en oubliant les autres processus n’étant pas uniquement territoriaux.
Une histoire sociologique doit au contraire situer la formation de l’État dans le système des interdépendances qui lui donne un sens, en l’inscrivant dans la consolidation du pouvoir central, tant financier que militaire. Ce processus permet les conditions de possibilité de la victoire de l’État royal sur les unités de puissance concurrentes, jusqu’à permettre une victoire du monopole royal et donc la différenciation d’un appareil de domination spécialisé, c’est-à-dire une « bureaucratie rationalisée » selon Weber. Cette monopolisation prend notamment la forme de conflits dynastiques, du dynamisme commercial, des conquêtes militaires… cela étant permis par le renforcement de l’État dès la fin du XVe siècle, et la mise en place d’appuis formels ou symboliques du pouvoir royal, notamment les rituels politiques. Ainsi, l’État s’autonomise par rapport au souverain, et renforce son monopole grâce à des acteurs spécialisés (comme des serviteurs du roi devenus agents de la bureaucratie) se mobilisant dans l’espace étatique.
La monopolisation : conquête des monopoles et conquête territoriale
On peut définir l’État « comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime » , ce qui est l’approche weberienne. C’est le résultat d’un processus que Norbert Elias qualifie de « sociogenèse de l’État » : l’État s’impose plutôt que d’autres formes de formations sociales en s’appropriant des ressources coercitives, économiques, symboliques, territoriales, financières et militaires, tout en pérennisant et justifiant sa domination grâce à des innovations et des transformations institutionnelles. Cette genèse est ainsi un processus d’accumulation des ressources vers un centre politique, grâce à une activité de concentration menée par des groupes spécialisés, et un processus de monopolisation inscrit dans une dynamique de compétition.
Les conditions de possibilité du monopole étatique se trouvent dans la société féodale, caractérisée par la dispersion des pôles de puissance : le roi se renforce par un processus d’accumulation territoriale, passant du statut de simple seigneur féodal au XIe siècle à celui de véritable souverain au XVe siècle. Les Capétiens du XIIe siècle (Louis VI et Louis VII) établissent ainsi le contrôle sur leur propre territoire grâce à des techniques militaires et financières, permettant à leurs successeurs de dominer une zone de compétition de plus en plus large. Il s’agit à l’époque d’une compétition dynastique et d’une domination patrimoniale, fondée sur des mariages, des achats et des conquêtes pour renforcer le domaine dynastique dans le cadre de cette dynamique de compétition. Au fil de son renforcement, le pouvoir royal peut ensuite tirer d’autres ressources, financières et militaires, du reste du royaume : il disposait de « chances de puissance » supérieures, se réalisant finalement et expliquant la suprématie capétienne tandis que le centre de gravité de la société se déplace vers un nombre plus restreint de grandes familles de chevaliers, menant à une hégémonie.
Ainsi, Philippe II, roi de 1180 à 1223, manifeste la supériorité de la puissance dynastique lors de la bataille de Bouvines en 1214 : la dynastie capétienne affirme son autorité vis-à-vis des autres dynasties et de la papauté, ainsi que son extension territoriale et son renforcement. Les batailles de cette époque impliquant le souverain résultent ainsi en l’affaiblissement ou le renforcement de l’autorité royale, selon leur résultat : à partir du XIIe siècle, il s’agit d’un cycle d’accumulation territoriale (conquêtes, batailles, consolidation). Les coalitions rivales se renforcent dans leurs domaines respectifs par l’élimination des concurrents territoriaux, avec des effets de cliquet : les héritiers conservent les gains de leurs prédécesseurs, et vont plus loin, par des stratégies d’acquisition de terres (matrimoniales, guerrières et marchandes).
Le pouvoir royal se renforce jusqu’à l’apogée capétienne au début du XIVe siècle, mais une seule administration centrale ne s’impose pas et les spécificités territoriales demeurent. La société évolue cependant, d’une société de guerriers luttant sans contraintes pour acquérir des terres, à une compétition à visée monopolistique entre moins de dynasties : les unités sociales de plus grande étendue sont favorisées. Après avoir établi une domination sur un territoire, l’étape suivante est ainsi de s’étendre sur un territoire plus vaste, formant des ensembles monopolistiques. En France, les Capétiens éliminent ainsi les dynasties concurrentes (comme celle des Plantagenêt) et évitent la dispersion des terres entre les héritiers du roi grâce au système des apanages, qui reviennent au roi en cas d’extinction de la lignée. L’autorité royale poursuit donc un travail de consolidation endogène, « réinventant » une loi salique pour justifier d’exclure les femmes de la succession et ainsi éviter l’accession du roi d’Angleterre au trône de France. Le processus de réduction des concurrences territoriales inter et intra-dynastiques permet ainsi l’émergence d’un monopole de domination étatique.
Un État fiscal se forme en même temps qu’un centre politique : les fonctions de domination se divisent, alors qu’apparaît un appareil administratif permanent et spécialisé. L’État se constitue ainsi comme un ensemble d’activités de concentration de ressources militaires et financières. Se renforçant, il transforme les luttes de pouvoir : alors qu’elles étaient des luttes pour l’abolition du monopole de domination (de l’État), elles sont désormais des luttes entre fractions élitaires pour l’accès aux positions dominantes dans l’État. Ce dernier cesse ainsi d’être contesté ; la lutte devient interne. L’impôt, d’abord une charge d’intérêt public sollicitée durant la guerre, acquiert le statut de ressource régulière. Au lieu d’acquérir du pouvoir contre l’État, des groupes élitaires choisissent comme stratégie d’ascension d’obtenir des fonctions militaires et financières au sein de l’État, qui devient un espace d’opportunités ou de reconversion. Le pouvoir central se développe avec des administrations gérant la puissance royale, mêlant les fonctions militaires et fiscales.
La puissance royale s’impose d’abord en concentrant la coercition physique grâce à la confiscation des ressources sociales et techniques, et à la maîtrise des conflits internes, pour aboutir au monopole de la violence physique légitime, notamment en interdisant les guerres privées au XIVe siècle, alors que le duel tombe en désuétude sous Louis XIV. Le cadre privilégié de l’action militaire devient ainsi le service du roi, avec la formation d’une armée permanente concentrant la coercition physique, remplaçant les compagnies de mercenaires. Les soldats doivent ainsi prêter serment au roi lui-même, chargé de nommer et de promouvoir les officiers.
Le deuxième mécanisme permettant l’affirmation de la puissance royale est la concentration de la contrainte financière : si la guerre s’impose comme nécessité structurelle pour renforcer l’État, elle justifie à son tour l’impôt, qui se généralise en tant que ressource alors que le pouvoir royal se reposait auparavant sur les revenus de son domaine. Des théoriciens des finances d’État développent ainsi des « justes raisons » légitimant le recours à l’impôt durant les conflits militaires, au nom du bien public, notamment au XVIe siècle chez Jean Bodin. Ce dernier affirme que le Trésor doit se fonder, outre sur les revenus du domaine, sur l’imposition. Des services dédiés au traitement des revenus de l’État s’institutionnalisent et stabilisent la gestion du monopole fiscal, fusionnant l’administration domaniale et fiscale. Les modalités d’extraction légale des ressources économiques se stabilisent malgré les contestations, en particulier à partir du XVIe siècles : tributs, loyers, taxes, paiements sur les biens immobiliers et la terre, et paiements sur les revenus monétaires. Les résistances se déplacent peu à peu vers la gestion juridictionnelle et policière des monopoles d’État et l’attribution des ressources.
La puissance publique : serviteurs de l’État et raison d’État
Alors que l’État s’est d’abord construit au profit d’un domaine patrimonial attaché à la personne royale et sa maison, des institutions spécialisées autonomes se sont formées pour répondre à des besoins nouveaux. Des fractions bureaucratiques apparaissent ainsi, se transformant parfois en intérêts collectifs opposés au pouvoir royal : un État dynastique (pouvoir traditionnel du roi et de ses serviteurs) s’oppose ainsi à un État bureaucratique (pouvoir légal rationnel avec une direction bureaucratique), les deux coexistant dans cette genèse de l’État moderne. Des mécanismes de transition mènent le pouvoir privé à devenir un pouvoir impersonnel exercé par des fractions élitaires, jusqu’à une autonomisation pratique et symbolique de l’État.
Ainsi, l’État dynastique est fondé sur le patrimoine et sur l’administration : le travail de domination se divise entre les membres de l’union dynastique et les fractions élitaires dotées de compétences techniques, menant à une contradiction des logiques de l’hérédité et de la compétence. Les nouvelles élites utilisent leurs ressources savantes pour conserver leurs positions acquises et développer leur rôle dans l’État : cherchant à reproduire leur pouvoir, ils veulent autonomiser l’État vis-à-vis du roi. C’est notamment le cas de l’administration fiscale qui impose au roi des règles formelles et informelles normalisant l’économie domestique du royaume. Ces élites prennent une part croissante dans l’État au cours des XIVe et XVe siècles, les classes urbaines émergentes accédant à des formations scolaires et universitaires contrôlées notamment par les villes, alors que l’écrit gagne en importance. Les études deviennent ainsi une voie d’ascension sociale pour les classes urbaines (notaires, marchands, artisans fortunés…), et même un espoir d’accession à la noblesse. Des compétences nouvelles s’introduisent ainsi dans la gestion de l’État, par exemple avec des principes de classement à partir de mises en forme écrites. L’État commence aussi à énoncer objectivement les normes morales et juridiques. Enfin, les nouvelles élites mobilisent leurs ressources relationnelles, notamment liées aux milieux financiers, pour lever des fonds servant l’expansion territoriale et les travaux voulus par les souverains. Ces nouvelles élites, qui se différencient, s’approprient aussi une part de la puissance publique, ce que certains monarques cherchent à empêcher.
Même ces fonctions spécialisées restent cependant sous l’autorité du roi, et elles contribuent donc à consolider le monopole étatique, comme les institutions royales domestiques dont certaines s’autonomisent aussi. L’institution ministérielle se développe de cette façon : d’abord à travers les « gens de son hôtel », le roi s’entoure ensuite d’une organisation plus efficace à partir du XIVe siècle du fait de l’extension du domaine royal, puis d’un ministerium regale avec des grands officiers de la couronne au sein de la cour du roi. Une dissociation entre les services domestiques du roi et les services de gouvernement se produit dans le même temps, notamment à travers l’exemple du Conseil du roi : d’abord organise de consultation de la haute noblesse au XIIIe, il se divise en plusieurs institutions, comme la cour de Parlement, la Chambre des comptes, et plusieurs conseils de gouvernement et d’administration.
La noblesse de sang, haute noblesse historique, se discrédite par son insubordination, et se trouve supplantée par d’autres groupes, les nobles étant alors confinés à des positions symboliques dans la maison du roi, alors qu’une nouvelle féodalité se développe avec la noblesse de robe, qui cherche à transmettre la puissance publique au sein de dynasties d’officiers. La charge de ces officiers est conservée à vie dès le XVe siècle, et devient peu à peu transmissible, permettant des stratégies de reproduction du pouvoir bureaucratique. Si l’État bureaucratique devient un espace d’opportunités, le roi cherche dans le même temps à mettre en place des stratégies pour limiter son autonomie, par exemple avec les commissaires révocables au XVIe siècle : leur fonction est d’informer le roi des abus des officiers pour les contrôler et les sanctionner. C’est donc cette fois le roi qui s’oppose à l’autonomisation des positions d’État, devenues un enjeu pour certains groupes sociaux.
Une raison d’État impersonnelle s’autonomise alors, par exemple de façon symbolique en recourant à des mots comme « la patrie » pour insister sur le caractère public de la fonction royale. L’État se rend distinct de la personne royale, du fait du travail des spécialistes du rationalisme d’État, qui imposent l’État comme une organisation nécessaire et irremplaçable, aux missions spécifiques. La personne du roi se sépare elle-même de l’institution qu’elle incarne, par exemple à travers la fiction juridique des deux corps du roi dès le XIVe siècle, le corps immortel du souverain se transmettant sans discontinuité. Cette continuité du pouvoir royal devient celle de l’État : la transmission de la couronne passe exclusivement par le sacre à partir du XIIIe siècle, et pour éviter tout danger durant l’interrègne, des réformes sont adoptées pour favoriser la vocation héréditaire de la couronne. L’immortalité juridique du roi se formalise ainsi, impliquant une souveraineté transcendant la personne royale. Ces évolutions sont normalisées par des « légistes » qui produisent un travail symbolique et juridique justifiant l’exercice des monopoles décrits. Le droit devient aussi l’apanage de spécialistes s’appropriant le monopole de ce savoir spécialisé, y compris au détriment du roi, tout en fondant juridiquement son autorité sur des constructions symboliques. En effet, l’autorité royale devient publique, légitimant tant le souverain qu’un personnel d’État spécialisé ; ce qui différencie une communauté publique, la patrie. Ce phénomène est favorisé par les crises de l’État dynastique, nécessitant une continuité étatique.
Aux XVe et XVIe siècles, puis sous le ministériat de Richelieu (1624-1642), les relations entre autorités se reconfigurent, et la raison d’État devient un enjeu de luttes, par exemple à travers l’expansion territoriale et coloniale et une subordination de la morale religieuse aux impératifs gouvernementaux. Richelieu affirme ainsi, grâce à des moyens institutionnels, la supériorité du principe de conservation de l’État, tant sur la morale religieuse que sur les droits communs. Une morale d’État autonome se développe ainsi par la pérennisation d’un service de plume et la fondation de l’Académie en 1634 : les divisions des « partis » et des « cabales » sont ainsi critiquées par les « littérateurs » , provoquant un retournement durable des hiérarchies symboliques traditionnelles à la faveur de l’État, dont l’extension est légitimé du fait des crises. Des pamphlets gouvernementaux défendent ainsi des principes définissant l’État comme une fin en soi, et légitimant par exemple l’usage de la morale religieuse à des fins tactiques, ou la limitation du rôle des parlements à des fonctions judiciaires. Ainsi, les groupes sociaux ayant intérêt, en raison de leurs fonctions en son sein, à faire durer l’État, participent à cette entreprise de légitimation de son utilité publique depuis le XVIe siècle, en fondant une religion de l’obéissance et une rhétorique insistant sur l’investissement désintéressé des gouvernants.
La formation bureaucratique s’autonomise donc et l’État se complexifie et se rationalise : la domination étatique se sophistique, avec des techniques telles que la statistique ou la cartographie pour connaître et maîtriser les populations. En raison de cette complexification, les élites se spécialisent comme fonctionnaires professionnels : les formes de recrutement du personnel d’État changent, avec davantage d’attention portée sur la qualification professionnelle et le concours. C’est pourquoi l’institution scolaire focalise les enjeux de reproduction du pouvoir d’État, surtout à partir du XIXe siècle : l’État obtient le monopole de la violence symbolique légitime en hiérarchisant la population par le verdict scolaire, qui devient une nouvelle ressource de légitimation. A la fin de ce siècle, les activités de légitimation de l’État se redéfinissent grâce à des réseaux scolaires spécifiques comme l’ENA et l’École polytechnique, prônant le « gouvernement de la compétence » .
Constructions pratiques et symboliques des frontières politiques
Enfin, selon Arnault Skornicki, un État est constitué juridiquement par la notion de souveraineté, sur une population et un territoire, mais il s’agit d’une construction historique, concurrente aux cités et aux empires. Ses frontières, pratiques et symboliques, se construisent selon plusieurs modalités.
Borner, mesurer, compter l’État
La maîtrise d’un territoire, et donc d’une frontière, nécessite d’abord de contrôler un espace grâce à des moyens matériels et humains : l’État moderne peut transformer l’espace naturel et social en territoire, un « lieu juridico-politique abstrait d’exercice de la souveraineté » . Il peut aménager son environnement pour le rendre productif et y faire circuler hommes et marchandises, tout en contrôlant la population, par des fortifications par exemple. Si le terrain est simplement cultivé et le domaine défini comme le fief d’un seigneur lié par des rapports interpersonnels à ses hommes, le territoire désigne quant à lui un espace politique et juridique mettant en rapport une population située sur un espace géographique déterminé avec un État administrateur. Les frontières se définissent donc progressivement, étant plus floues au Moyen Âge, et concernant d’abord les frontières intérieures marquées par des lignes de défense (comme des châteaux forts) et des déplacements fréquents. Ces limites politiques deviennent administratives, judiciaires ou coutumières au XIVe siècle : les frontières marquent alors l’étendue spatiale et géographique de l’autorité du souverain. Elles deviennent ainsi les frontières d’un pays, une limite plutôt qu’une large zone de séparation. Le déplacement des frontières ne suit plus une logique territoriale et nationale, mais dynastique et impériale, notamment durant la guerre de Cent Ans à la fin de laquelle l’Angleterre est chassée du territoire français.
La frontière existe ainsi lorsque le roi développe son autorité sur un espace étendu, à l’aboutissement d’une histoire longue constituée d’une compétition militaire, vers les années 1550 et 1560 en France, lorsque le pays trouve ses limites dans les représentations, avec l’idée des « frontières naturelles » défendue par la suite par Richelieu. Sous Louis XIV, de nombreuses conquêtes permettent de fixer le territoire français, tout comme l’annexion ultérieure de la Lorraine et de la Corse. Alors que les frontières se stabilisent, la souveraineté royale s’affirme, notamment grâce aux voyages du roi. C’est la guerre de Cent Ans qui permet à l’État d’assurer ses frontières maritimes et d’imposer son monopole fiscal, justifié par l’armée régulière financée par la taille. L’expansion britannique reprend quant à elle à partir du XVIIe siècle, dans des directions commerciales et maritimes plutôt que militaires et continentales comme sous les Plantagenêt. Après la Glorieuse Révolution permettant l’avènement d’une monarchie limitée et parlementaire, l’élite de la gentry et de la bourgeoisie marchande choisit en priorité le développement économique à la guerre, mettant en place une politique commerciale agressive, menant à un empire colonial à la suite de la guerre de Sept Ans (1756-1763).
L’État, dans le sillage des révolutions scientifiques, constitue des savoirs sur le territoire et la population pour obtenir le monopole de la violence légitime. Il s’agit par exemple de la géographie et de la cartographie, dont l’objectif est de modifier la réalité au lieu de simplement l’analyser, notamment en définissant les frontières naturelles de la France. Cependant, les frontières politiques se stabilisent à l’ère moderne, et l’objectif de la souveraineté n’est plus tant d’utiliser la loi et l’appareil policier et administratif pour faire obéir un peuple sur un territoire donné, que de faire prospérer économiquement une population sur ce territoire. C’est donc l’essor du mercantilisme : des discours et pratiques politico-économiques issus de la Renaissance et du commerce international, avec pour objectif d’accroître la population et de développer l’économie par l’industrie et les exportations pour affermir l’État territorial. Le peuple, désormais intégré, est considéré comme un sujet juridique d’obéissance et à présent comme une population naturelle dont il faut augmenter la productivité, par exemple en favorisant la natalité et en orientant la production. Les États, notamment en Allemagne, s’orientent vers l’économie, par le mercantilisme puis par le libéralisme, toujours dans l’objectif du bien public malgré la diversité des moyens, et en s’appuyant sur la connaissance du sujet de leur action.
Les États cherchent donc à dénombrer et classer les hommes et territoires, par des savoirs démographiques, économiques et sociaux dès le XVIIe siècle, par exemple avec la statistique pour rendre prévisible et manipulable le monde social en éclairant l’action publique et notamment la politique fiscale. Ces savoirs s’institutionnalisent et se spécifient alors que se construit l’État, à travers des académies royales en France, notamment l’Académie des sciences en 1666 : elles ont une fonction d’expertise scientifique pour le gouvernement, alors que le corps d’ingénieurs des Ponts et Chaussées (en 1716) doit créer des routes et voies navigables pour unifier le marché national grâce à la circulation. L’homogénéisation est consacrée par la Révolution qui uniformise le système de poids et de mesures, découpe le territoire en départements et instaure le code civil.
Ainsi, ce progrès technoscientifique valorise la rationalisation weberienne : la manipulation technoscientifique de l’environnement naturel et social, dans un contexte concurrentiel entre États demandant toujours plus de prospérité et donc de puissance. Il faut donc innover dans la technologie par le biais des savants et ingénieurs, ce qui donne lieu à la machine à vapeur en Grande-Bretagne par exemple.
Représenter l’État
Davantage qu’une action matérielle, l’État est aussi une symbolique, favorisant sa justification intelligible permettant de faire accepter son monopole de la domination : la population doit croire en cette violence, en cette domination sur les corps. L’État doit donc, de façon paradoxale, faire oublier qu’il est constitué avant tout de la domination d’un groupe sur d’autres, et se montrer comme représentant l’intérêt général, grâce au pouvoir de l’image (artistes, architectes…) et des concepts (philosophes et juristes), permettant aux gouvernés de s’identifier à l’État.
Il s’agit d’abord de frapper les gouvernés par l’imagination, à travers des représentations visuelles, une mise en scène de l’État favorisant l’intériorisation de la légitimité de son pouvoir. C’est le cas de la monarchie absolue française, qui se donne un caractère sacré et intemporel pour faire oublier son caractère humain, historique et profane : la transcendance de l’État est mise en scène, notamment à travers le roi, grandi par son appellation (le « Roi Soleil » par exemple) et la mise en scène de son corps. Le roi incarne ainsi la nation, physiquement, ce que rationalise la théorie des deux corps du roi, avec un corps physique et un corps mystique et politique, tout comme la royaume serait une entité organique immortelle. Cette théorie est dramatisée par quatre grands cérémonials : les funérailles, le sacre et le couronnement, l’entrée du roi à Paris et le lit de justice. Le roi est habillé de façon à renforcer son caractère majestueux, pour manifester ce qu’il veut être : un corps politique qui le dépasse, une royauté perpétuelle, comme l’État, qui se distingue ainsi de la personne du roi. Des signes matériels confirment le pouvoir suprême du roi incarnant l’État, comme la couronne et la monnaie où son image est frappée, mais aussi les beaux-arts. Versailles matérialise ainsi la souveraineté absolue. La société de cour ritualise enfin toute l’existence du roi, même dans ses éléments quotidiens, magnifiés par l’étiquette. Tout ceci concourt donc à ce qu’en France, le roi devienne le principe d’unité de la nation, synthétisant son corps naturel et le corps politique national – ce qui n’était pas le cas, par exemple, en Angleterre, où le corps politique était au Parlement.
L’autre pan de la représentation de l’État est qu’il se donne à penser, par le biais du droit et de la philosophie politique, en produisant des discours légitimateurs. C’est la tâche de groupes spécialisés, les juristes et philosophes, qui sont situés socialement. Cela peut les amener à légitimer le statu quo à travers des idéologies, à proposer des réformes, ou à justifier la révolution au nom d’utopies. L’État peut donc utiliser ces travaux pour conforter sa légitimité : ils peuvent ainsi affecter l’ordre politique lorsque des acteurs s’en saisissent. La souveraineté est ainsi un concept juridico-politique développé par ces philosophes, et devient le fondement de la théorie juridique de l’État, légitimant dès la Renaissance l’État français grâce au juriste Jean Bodin. Ce dernier la définit comme une « puissance absolue et perpétuelle » . Il la justifie par l’autonomie de la raison politique, qui doit permettre la paix civile, et la nécessité d’une autorité absolue, unique et indivisible, pour y parvenir. La souveraineté doit être un pouvoir législatif monopolistique, incontestable, alors que le citoyen doit obéir sans condition à la loi, comme sujet. Au XVIIe siècle, la « raison d’État » est théorisée comme ensemble des techniques et justifications de l’exercice du pouvoir par l’État. Pour légitimer la place des dirigeants, la théorie du droit divin est également développée, malgré le caractère contingent de l’ascension des Capétiens : il s’agit ici de sacraliser la dynastie et d’adjoindre l’idée que tout pouvoir vient de Dieu au concept de souveraineté, comme si le pouvoir capétien n’était pas historique.
Cependant, des conceptions républicaines du gouvernement, concurrentes à la monarchie absolue, se développent aussi, par exemple aux Provinces-Unies dès le XVIIe siècle, puis au XVIIIe siècle avec les Lumières puis la Révolution : la représentation politique et la citoyenneté deviennent des objets de lutte, et la délégation du pouvoir par l’élection et le vote par tête des enjeux.
Conclusion
L’État, comme Rome, ne s’est pas fait en un jour. Il est le résultat d’un ensemble de processus de très long cours, au fil d’une histoire (par certains aspects encore inachevée) dont on peut trouver les origines au IXe siècle, avec l’effondrement du pouvoir carolingien et la formation d’une myriade de principautés locales sous le contrôle de châtelains s’appropriant le pouvoir de commandement. Il n’existe, alors, pas d’État en France : des seigneuries concurrentes dominent de petits territoires à l’aide de relations interpersonnelles, d’homme à homme.
Un ordre nouveau, dit féodal, se structure alors, entre cette dislocation du pouvoir carolingien au IXe siècle et le XIe siècle, lorsque les premiers capétiens s’installent sur le trône de France et marquent le début d’un mouvement inverse. Ainsi, le pouvoir royal s’étend au sein de cet univers social de plus en plus restructuré par les trois ordres et les liens de vassalité contribuant à stabiliser les groupes : grâce à des techniques de domination comme la justice royale et la fiscalité monarchique, les souverains parviennent entre les XIe et XIVe siècles à entamer la construction d’un véritable État.
Ainsi, cet État se construit tant à travers les discours que par les techniques financières et militaires mises en œuvre par un personnel de plus en plus spécialisé. L’État mobilise des ressources de diverses natures (coercitives, économiques, symboliques…) pour les rassembler en un centre politique, faisant du roi un véritable souverain au XVe siècle, grâce à des mariages, des conquêtes ou des achats de territoires. Une administration se développe aussi, de façon spécialisée : après un travail de conquête et de domination, c’est un travail de consolidation qui permet à l’État de mettre en place son monopole de domination. L’administration est constituée d’un personnel formé dans cette optique, et représente alors un nouvel espace d’opportunités pour les élites urbaines, qui veulent consolider leur statut en développant la notion de raison d’État pour distinguer l’État du souverain et incarner un pouvoir autonome, en légitimant l’État qu’elles contribuent à construire.
L’État, enfin, se matérialise par un processus de classement, de délimitation de son territoire, des hommes et des choses, qu’il cherche à connaître en constituant des savoirs spécifiques et ainsi en se donnant les moyens de maîtriser la population et le territoire grâce au monopole de la violence légitime. Il met en place une action symbolique de représentation pour se donner à voir, notamment à travers le souverain, mis en scène dans toutes ses actions ; il se donne aussi à penser, par le droit et la philosophie politique, pour se légitimer intellectuellement en conceptualisant par exemple la souveraineté.
Ainsi, l’État moderne, loin d’être une évidence, est en réalité une construction historique : il est le résultat d’une opération réussie de domination d’un groupe social, d’abord les Capétiens en France, puis les Valois et les Bourbons. Cette domination, qui a avant tout été une conquête militaire, est tout simplement l’imposition progressive d’un monopole de la violence légitime, assorti d’une capacité à lever un impôt de plus en plus permanent, notamment à travers une administration spécialisée. Un travail symbolique de légitimation a posteriori, par les représentations visuelles et les discours en particulier, a ensuite été mis en place, pour justifier cette domination et même la faire oublier, en théorisant des concepts tels que le droit divin. Malgré la Révolution, cet État demeure : la souveraineté qu’il possède, exercée par ses représentants, appartient désormais simplement au peuple.
- COHEN Antonin, LACROIX Bernard, RIUTORT Philippe (dir.), Nouveau manuel de science politique, 3e édition revue et augmentée, Paris, La Découverte, 2024, 816 p. ↩︎
